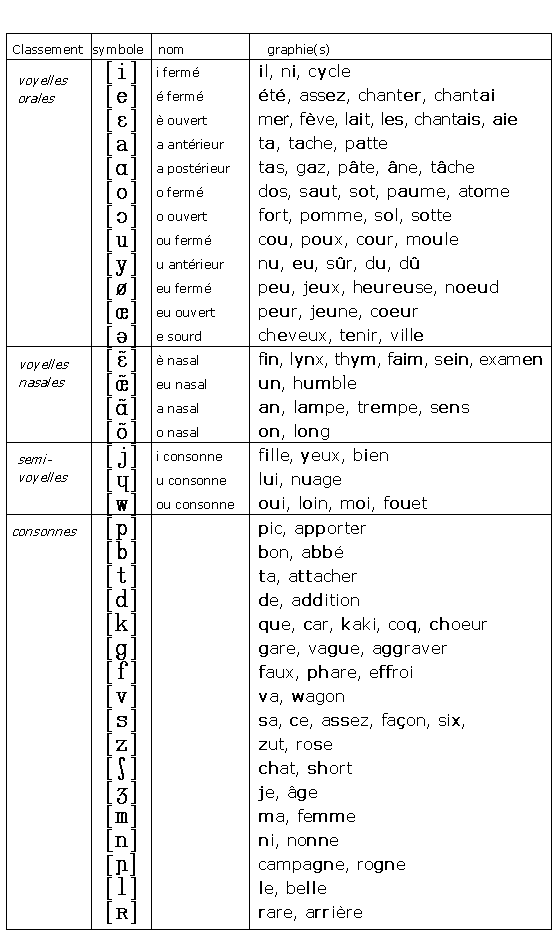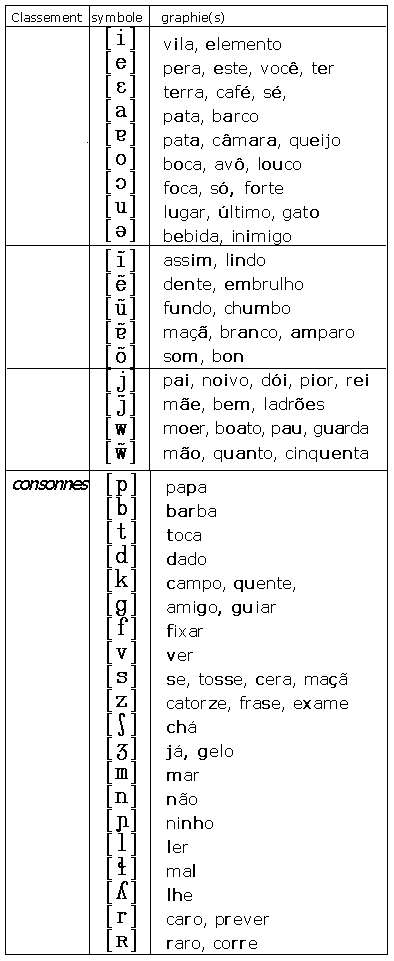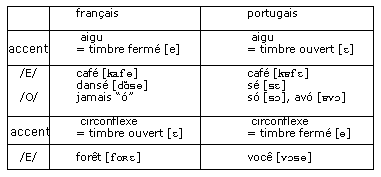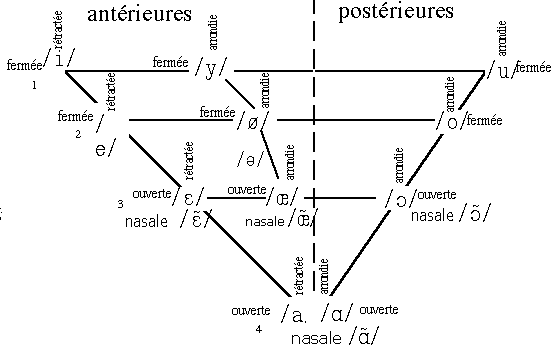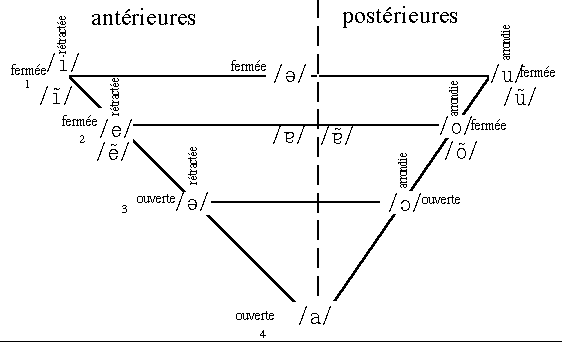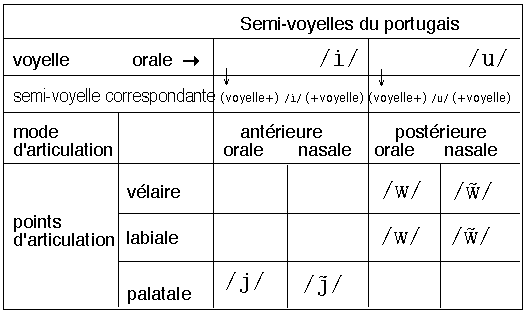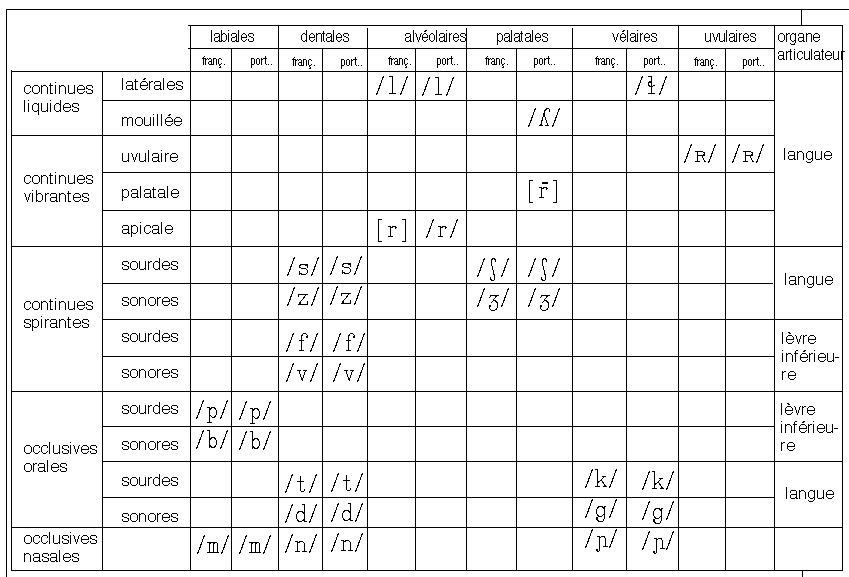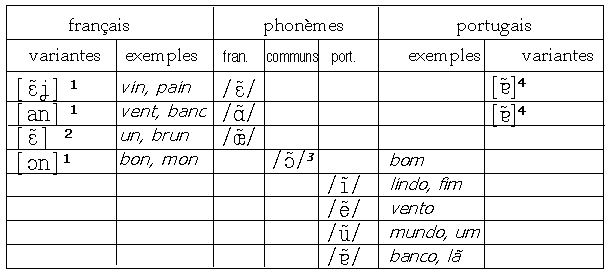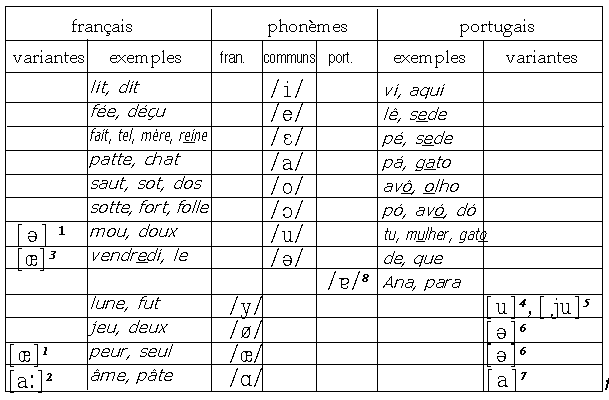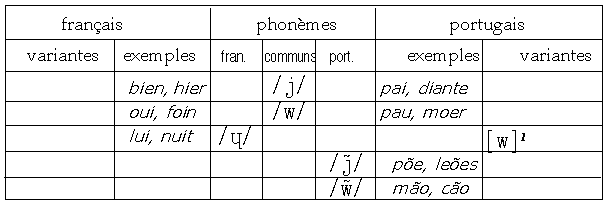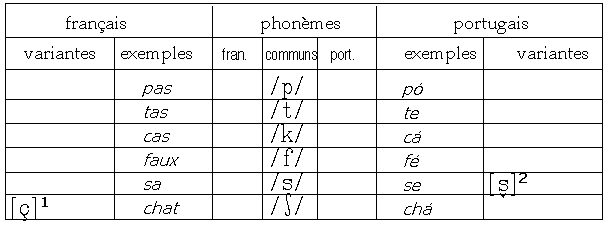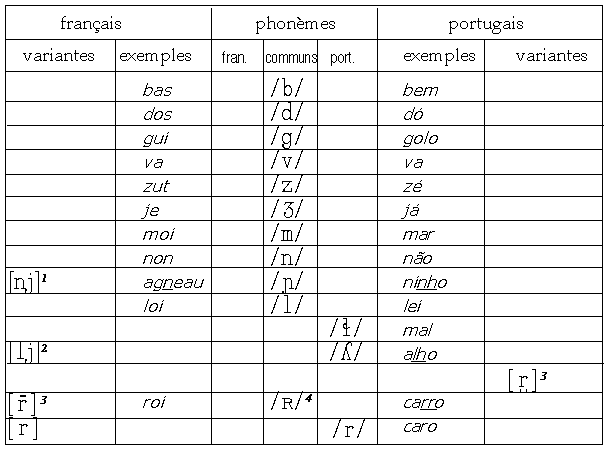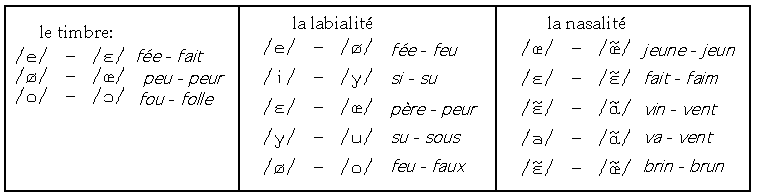-
ORTHOÉPIE ET INTERFÉRENCE EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE Fernando Martinho (Departamento de Línguas - Universidade de Aveiro) 1993 Copyright. - 0.Introduction
- 1.Les matériaux phoniques
- 1.1.Transcription phonétique du français
- 1.2.Transcription phonétique du portugais
- 2.Description articulatoire comparée
- 2.1.Le système vocalique
- 2.2.Le système consonantique
- 2.3.Inventaire comparé
- 2.4.Un exemple d'interférence phonétique: les voyelles fondamentales
- 3.Interférences phonologiques
- 3.1.La chaîne parlée
- 3.2.Fréquences d'emploi
- 3.3.Distribution comparée
- 3.4.Habitudes syllabiques
- 3.5.Distribution des voyelles à double timbre
- 4.Conclusion
- 4.1.Interférences et enseignement du français
- 4.2.La place du français parlé en FLE
- 4.3.[bR
 ]
ou [bR
]
ou [bR ]
? Le problème de la norme en FLE
]
? Le problème de la norme en FLE - 4.4.Le français parlé à l'Université.
- Bibliographie
Les notes sont en fin d'article -
INTRODUCTION - 1.L'étude et la prise en compte du français parlé a connu, de la part des enseignants de Français Langue Étrangère (FLE), un intérêt croissant. Cet intérêt coincide avec un virage dans la tradition grammaticale qui avait toujours privilégié les données de l'écrit en tant qu'objet de description et d'enseignement.
- On ne peut nier que le français parlé soit un objet d'enseignement important en FLE. Cependant, le fait que certaines études portant sur la situation du code oral aient pu partir du principe que la langue parlée relève du populaire, du familier (1), qu'il est donc hétérogène, qu'il se prête difficilement à une description systématique, parce qu'il est propice à des perturbations inclassables (hésitations, répétitions, ruptures de ton, etc), implique qu'il ait souvent été, en vue de la pratique du FLE, considéré comme non-passible d'être décrit, en opposition claire au français écrit, qui, lui, apparaît comme objet de la grammaire.
- L'expression "langue française" désignant indifféremment le français parlé et le français écrit, nous serions d'ailleurs condamnés et nous condamnerions nos élèves à faire abstraction des divergences qui séparent ces deux codes.
- Une telle vision est bien entendu fondée sur le préjugé d'une opposition définitive entre oral et écrit (2) et ne résiste pas à l'analyse: le code oral, en apparence hétérogène et ennemi de la classification, révèle cependant un caractère systématique prononcé et susceptible d'être enseigné.
- Les conditions physiques et matérielles de l'acquisition de la langue étrangère (approche articulatoire et/ou distinctive, élocution, correction phonétique, entraìnement prosidique et intonatif, etc) sont elles-aussi l'objet de préjugés dans le domaine de l'enseignement de la langue. La plupart des enseignants semblent partir du principe que ces conditions matérielles ne comptent pas vraiment, ou, au mieux, ne comptent pas en face des impératifs de la grammaire. On peut cependant se demander si la connaissance et la maîtrise de la "substance de l'air" (M.Arrivé) n'est pas au moins aussi urgente que celle de la "substance de l'encre".
- C'est ainsi que le corpus réuni par certains chercheurs sur le français parlé (A. Martinet, J. Dubois, C. Blanche-Benvéniste, P. Léon, H. Walter, F.et D. François, E. Companys, M. Csécsy, N. Catach, Straka, etc) a permis, au cours des années, de corriger certaines des lacunes d'une approche pédagogique limitée au code écrit (3) L'entreprise d'élaboration d'une description systématique du français parlé et écrit est une des voies les plus productives de la linguistique française (4), caractérisée par une tendance consistant à refuser la dichotomie oral/écrit, et à considérer une grammaire du français tout court (5).
- Le présent travail prétend essentiellement faire le point sur le travail d'enseignement de la prononciation en FLE, en particulier à des étudiants lusophones, dont la formation est elle même orientée vers l'activité lective. Nous laisserons ainsi de côté les problèmes posés par ce que l'on a appelé ailleurs la "syntaxe du français parlé" (C. Blanche-Benvéniste), pour nous tourner précisément du côté de la substance de l'air, des conditions de l'enseignement de la phonétique en classe de FLE.
- 2.En FLE, l'intégration de la composante orale dans la description grammaticale doit se faire avec des précautions particulières. En effet, les conditions spécifiques que suppose l'enseignement du français parlé à des étrangers, en particulier à des Portugais, nous obligent à redéfinir la place à attribuer à la phonétique et à la phonologie françaises en FLE.
- Quelles difficultés se posent à un
enseignement systématique et programmé du code
oral, singulièrement d'un code oral étranger? La
principale vient sans doute de l'exigence de rigueur requise
par toute transcription. En effet, l'auditeur et le locuteur,
en FLE, sont constamment soumis, lors de leur travail, à
certains facteurs de blocage ou d'interférence.
L'auditeur (l'élève), par exemple, est victime de
phénomènes relatifs à la segmentation des
mots et des énoncés, à l'anticipation ou
au rétablissement de certains éléments
absents, ou tout simplement à des confusions
acoustiques. Par ailleurs, sur le plan de la
compréhension, l'enseignant sait que certains de ces
blocages sont annulés par le respect et la connaissance
de certaines habitudes intonatives et phonosyntaxiques du
français. Ainsi, par exemple, lorsque un non-francophone
parle français devant des francophones, ces derniers le
comprendront d'autant mieux qu'il appliquera les "moules
syntaxico-intonatifs" (6) habituel du français, et
cela même si des imperfections articulatoires se glissent
dans sa production (comme le /i/ pour /y/ ou /nj/ pour
/
 /)
.
/)
. - Inconsciemment (?) donc, l'auditeur joue avec la probabilité de l'occurrence d'éléments que lui-même produit dans sa langue maternelle (7), ou qu'il estime (8) produits par le locuteur (ici le professeur, ou un locuteur "transposé", comme une bande magnétique).
- Du point de vue de la perception, ces "hallucinations auditives" (9) peuvent aller jusqu'à induire l'élève à entendre et écrire (le danger est là) quelque chose que le locuteur n'a jamais prononcé. Tout se passe en fait comme si le système phonologique de l'élève, celui qu'il tient de sa langue (langue-source), interposait des barrières à une perception acceptable de la langue-cible. Pourtant, pour avoir accès aux micro-systèmes grammaticaux caractéristiques du français parlé, et dont seule l'étude détaillée permet de bien posséder la langue dans son ensemble, il est indispensable à l'élève étranger de posséder une connaissance objective des caractéristiques articulatoires du français.
- Dans le cas du FLE enseigné à des Portugais, les problèmes de prononciation rencontrés tendent à être le reflet des caractéristiques phonétiques et phonologiques du portugais, principalement les interférences dans l'articulation et la perception des voyelles.
syortinf - 3.Quelques questions se posent au professeur chargé de la prononciation française, auxquelles nous nous proposons de répondre en partie dans ce travail:
- -comment enseigner une articulation étrangère différente de l'articulation portugaise tout en se préoccupant de faire acquérir dès le début une bonne orthoépie?
- -comment délimiter et intégrer méthodologiquement l'apprentissage de la prononciation française dans l'enseignement de la langue étrangère?
- -comment lever les obstacles articulatoires et auditifs induits préalablement par le système phonologique portugais?
- -comment, enfin, distinguer ces interférences articulatoires de fautes liées au processus d'apprentissage lui-même? En d'autres termes, sur quels critères séparer les erreurs de prononciation (appelons-les de compétence) et les fautes de grammaire (habituelles dans le processus d'apprentissage du FLE, appelons-les fautes de performance)?
- Les erreurs liées à la performance de l'élève, à l'apprentissage lui-même, ne font qu'illustrer son niveau par rapport au FLE. De telles erreurs ne sont pas liées (exclusivement) à l'interférence de la langue maternelle mais bien à la langue étrangère en soi, et constituent d'ailleurs la preuve de sa (bonne) connaissance de la langue maternelle. Les erreurs qu'on qualifie ici de compétence proviennent quant à elles de l'application, inconsciente ou irréfléchie, en FLE, d'habitudes et de règles existant en portugais dans des contextes spécifiques, ce qui a pour résultat de modifier systématiquement la prononciation exigée par la langue française.
- Cette distinction entre erreurs de compétence et erreurs de performance permet, dans la pratique du FLE, de séparer ce qui peut être mis sur le compte de l'épisodique, de l'accessoire (mauvaise compréhension d'une règle, oubli d'une forme, méconnaissance de la morphologie, tout ce qui touche à ce que le professeur enseigne habituellement sous le nom de "grammaire"), de ce qui est à attribuer à l'influence des habitudes articulatoires de la langue-source.
- A l'intérieur des erreurs de compétence en FLE, nous devons aussi établir une deuxième distinction: séparer les fautes articulatoires des fautes fonctionnelles. Dans le premier cas, les incorrections articulatoires constatées en FLE sont généralement le résultat de la transposition d'une articulation de la langue maternelle vers le français, et peuvent, à l'aide de la méthode phonétique, être en partie corrigées (par exemple par le recours à l'alphabet phonétique et aux exercices de prononciation).
- Dans le deuxième cas, ce n'est pas une simple articulation portugaise qui est transposée en français, mais bien une caractéristique phonologique (qui, logiquement, est absente du système phonologique visé). Ainsi, pour prendre un exemple, peut-on dire que la tendance portugaise à réduire le timbre des voyelles atones (le système des réductions vocaliques) (10) pose de graves problèmes pour la prononciation des voyelles du français, langue où toutes les voyelles sont également accentuées et ne connaissent de variation de timbre qu'en fonction des modèles syllabiques.
- 4.C'est dans cette perspective que nous nous proposons de réfléchir à certaines des fautes de compétence les plus caractéristiques du FLE enseigné à des lusophones, ceci en proposant une analyse contrastive systématique du système phonologique maternel et de celui dont l'acquisition est en jeu. La phonologie comparée des deux langues peut en effet expliquer les interférences d'un système sur l'autre, que ces interférences soient dues à une distribution différente d'un même phonème (commun aux deux langues), ou à la non-correspondance d'un phonème dans l'autre langue (phonèmes unilatéralement portugais ou français).
- Il est possible de tirer de la confrontation entre les deux systèmes quelques enseignements sur la prononciation en FLE, comme par exemple les interférences liées à la position des consonnes, ou le conditionnement des timbres vocaliques dû à l'accent:
- -La distribution des consonnes: en portugais, de
même qu'en français, existent des consonnes
occlusives: /p/, /t/, /k/, etc. Cependant, en portugais,
ces sons n'existent habituellement pas en fin de syllabe, et,
plus généralement, pas en finale absolue, alors
qu'en français, ces consonnes existent dans toutes les
positions, y compris en finale, comme le démontrent les
exemples suivants: "action"
[aksj
 ]
, ou "cap" [kap], ou
encore "exception" [
]
, ou "cap" [kap], ou
encore "exception" [ ks
ks psj
psj ].
En conséquence, le locuteur portugais qui doit prononcer
un mot (ou une syllabe) français terminé par une
occlusive, aura tendance à lui ajouter une voyelle
finale supplémentaire, c'est-à-dire une syllabe:
"ca-pe" *[kap
].
En conséquence, le locuteur portugais qui doit prononcer
un mot (ou une syllabe) français terminé par une
occlusive, aura tendance à lui ajouter une voyelle
finale supplémentaire, c'est-à-dire une syllabe:
"ca-pe" *[kap ].
Dans une telle prononciation, la consonne occlusive ne termine
plus une syllabe, mais commence la suivante, ce qui est plus
conforme aux habitudes distributionnelles du portugais.
Concluons-en donc qu'un même phonème peut exister
en français et en portugais, mais qu'il suffit que sa
distribution soit différente pour que
l'élève ait des difficultés à
l'identifier.
].
Dans une telle prononciation, la consonne occlusive ne termine
plus une syllabe, mais commence la suivante, ce qui est plus
conforme aux habitudes distributionnelles du portugais.
Concluons-en donc qu'un même phonème peut exister
en français et en portugais, mais qu'il suffit que sa
distribution soit différente pour que
l'élève ait des difficultés à
l'identifier. - -Voyelle et accent: pour prendre l'exemple de l'influence de l'accentuation sur l'articulation du timbre vocalique (voir le développement au dernier chapitre), il nous faut distinguer en portugais l'articulation des voyelles selon qu'elles sont accentuées ou atones, un système vocalique autonome existant pour chaque cas (11) En français, cependant, l'accent porte par défaut sur la syllabe finale, ce qui implique que sa place est fixe et que, de ce fait, l'articulation des voyelles ne peut être modifiée par une altération de l'accentuation. Il convient donc, en FLE, d'apprendre à prononcer les mots en les accentuant seulement sur la dernière syllabe (le problème inverse se pose en portugais langue étrangère avec une certaine acuité, en particulier aux enfants d'immigrés). Il s'agit d'acquérir une habitude prosodique (dans ce cas l'accent) particulière au rythme du français (les Français ne savent pas ce que signifie accentuer un mot autrement que sur la syllabe finale), mais, par ailleurs, cette fixité de l'accent français constitue une entrave aux habitudes accentuelles du portugais (un Portugais est habitué à déplacer l'accent selon le cas et à accentuer les syllabes non finales). En conséquence, devant l'audition du français 'authentique', un élève en conclura que les énoncés oraux français sont monotones, sans relief, et donc les syntagmes difficiles à délimiter et les mots impossibles à isoler avec clarté.
- 5.Nous nous proposons donc de définir en un système cohérent ces interférences (12) entre les deux systèmes phonologiques (13)
- Les difficultés de l'apprentissage du FLE proviennent, comme pour toute langue étrangère, du fait qu'il se présente comme un ensemble d'habitudes nouvelles qui doivent se superposer à celles qu'on possède déjà et éventuellement les contrarier. L'étudiant de FLE se voit ainsi exiger une double compétence: réaliser l'acquisition d' un système phonologique nouveau, et en même temps différencier deux systèmes phonologiques concurrents.
- Etant donné que les fautes de compétence se font de la langue maternelle vers la langue étrangère, il est nécessaire de comparer les deux systèmes phonologiques comme un moyen de prévoir et expliquer les fautes de prononciation rencontrées (14)
- L'interférence des systèmes phonologiques
consiste à prétendre parler une langue
étrangère avec son propre système
phonologique. L'un des principaux risques est que, dans
certains cas, l'apprenant fasse appel à des raccourcis
articulatoires ambigus (15): face à l'incapacité
d'assurer des articulations qui lui sont
étrangères, mais devant obéir aux
impératifs de la communication orale, il se livre
à des substitutions d'articulations. Ainsi l'opposition
/
 /
- /
/
- / /
n'est-elle pas pertinente en portugais, mais elle l'est en
français: une conséquence possible en FLE est de
tenter de maintenir une différence entre des mots qui en
français se distinguent justement par cette opposition
vocalique, par exemple, "vent" et "vin". Ne
pouvant le faire sur des articulations qu'il lui est impossible
d'effectuer (l'élève les remplace par la nasale
portugaise /
/
n'est-elle pas pertinente en portugais, mais elle l'est en
français: une conséquence possible en FLE est de
tenter de maintenir une différence entre des mots qui en
français se distinguent justement par cette opposition
vocalique, par exemple, "vent" et "vin". Ne
pouvant le faire sur des articulations qu'il lui est impossible
d'effectuer (l'élève les remplace par la nasale
portugaise / /),
l'élève peut jouer sur des considérations
parallèles, comme l'allongement (16) vocalique:
*/v
/),
l'élève peut jouer sur des considérations
parallèles, comme l'allongement (16) vocalique:
*/v :/ (vent) et */v
:/ (vent) et */v /
(vin).
/
(vin). - Autre exemple: les voyelles labiales /y/
et /
 /,
absentes du portugais, et que l'élève
réalise, par compensation, en recourant à des
voyelles portugaises phonétiquement proches,
comme /e/ ou
/i/.
/,
absentes du portugais, et que l'élève
réalise, par compensation, en recourant à des
voyelles portugaises phonétiquement proches,
comme /e/ ou
/i/. -
6.Ces exemples classiques en FLE conduisent à la définition de trois types d'interférence possibles:
- -les cas où il y a identité de
phonèmes dans les deux langues: le seul
problème se résume alors aux
(éventuelles) différences de distribution des
diverses réalisations du phonème. Ainsi, une
même voyelle peut présenter, dans les deux
langues des timbres identiques, mais dans des contextes
opposés: c'est le cas de /O/,
qui, en français comme en portugais réalise
les deux timbres [o] et
[
 ],
mais pas dans la même syllabe: en français, le
timbre [
],
mais pas dans la même syllabe: en français, le
timbre [ ]
est exclu en syllabe ouverte accentuée.
]
est exclu en syllabe ouverte accentuée. - -les cas où il y a phonèmes voisins (mais
non identiques) dans les deux langues, comme le /
 /
français et le /
/
français et le / /
portugais, où se produit un phénomène
de transposition articulatoire plus ou moins transparente au
locuteur.
/
portugais, où se produit un phénomène
de transposition articulatoire plus ou moins transparente au
locuteur. - -les cas où un phonème n'a pas
d'équivalent direct ou indirect dans l'autre langue,
comme la voyelle française /y/
ou la consonne portugaise /
 /:
dans le système acquis existe une articulation qui se
caractérise par son absence dans le système
maternel (ou alors c'est le système maternel qui
possède un phonème inconnu dans le
système appris). C'est la situation la plus
délicate, celle où les erreurs de
compétence sont les plus visibles. Les
réalisations de ces articulations seront
systématiquement assimilées à celles
d'articulations maternelles, selon un réseau
caractéristique de correspondances articulatoires.
C'est en fait à ce niveau que se situe
véritablement l'apprentissage de la prononciation
d'une langue étrangère.
/:
dans le système acquis existe une articulation qui se
caractérise par son absence dans le système
maternel (ou alors c'est le système maternel qui
possède un phonème inconnu dans le
système appris). C'est la situation la plus
délicate, celle où les erreurs de
compétence sont les plus visibles. Les
réalisations de ces articulations seront
systématiquement assimilées à celles
d'articulations maternelles, selon un réseau
caractéristique de correspondances articulatoires.
C'est en fait à ce niveau que se situe
véritablement l'apprentissage de la prononciation
d'une langue étrangère. - On peut donc en conclure que l'acquisition du français parlé, en situation de FLE, repose sur une problématique précise: apprendre un système phonologique étranger qui vient se superposer au système phonologique portugais, et qui coincide avec celui-ci que très imparfaitement (Une autre question, qui ne sera pas ici abordée, tient au décalage oral/écrit: l'élève doit faire face à un système graphique n'ayant qu'un rapport distant et hésitant avec le système phonologique en question).
-
Le plan de ce travail sera le suivant:
- -l'accent sera d'abord mis sur l'étude systématique du matériau phonique des deux langues et de leurs rapports respectifs avec la graphie (les sons et leurs équivalents graphiques);
- -nous essayerons ensuite de décrire et comparer les systèmes articulatoires en présence;
- -nous présenterons enfin une analyse contrastive de certains aspects des systèmes phonologiques du portugais et du français: les phonèmes standard et leur variations, les différences de position, les fréquences d'emploi, les habitudes syllabiques et distributionnelles, et enfin l'analyse comparée de la distribution de quelques voyelles instables.
1.ANALYSE DES MATÉRIAUX PHONIQUES - Quand on parle français, de quel ensemble de sons dispose-t-on? Y en a-t-il de différents en français et en portugais? Comment classer ces sons et leurs différences? Peut-on partir des repères de lecture?
- Certains problèmes rencontrés par les enseignants liés au FLE sont caractéristiques de la distance qui, en français, sépare oral et écrit. Ce décalage pose donc aussi la question fondamentale de l'acquisition de la lecture et ses rapports avec la prononciation, rapports qui, en langue portugaise, ne se posent pas dans les mêmes termes.
- On ne peut comprendre en la considérant isolément l'organisation de la langue écrite, car, quelles que soient les divergences entre orthographe et prononciation, les lettres de l'alphabet sont primordialement des représentants de phonèmes (N. Catach). Mais si l'organisation de la langue écrite ne se conçoit vraiment que par rapport à l'analyse orale, on doit aussi remarquer que la connaissance du système graphique peut gêner l'acquisition du système oral, selon leur degré de divergence. Dans le cas du français, les interférences négatives de l'écrit sur l'oral l'emportent sur les positives (en particulier la non-correspondance régulière son-lettre) (17)
- L'analyse de la transcription en français et en portugais effectuée en classe par les étudiants leur permet d'illustrer assez bien certaines de ces interférences oral-écrit:
- - la dissymétrie du nombre d'unités relevées dans chaque code en français. Cette dissymétrie est toujours favorable au code oral (autrement dit, le nombre d'unités orales est toujours inférieur). La dissymétrie en portugais est beaucoup moins sensible.
- - cette quasi-équivalence entre matériau graphique et phonique (une unité de chaque code) est un fait caractéristique du portugais. Au contraire, la non-correspondance bilatérale entre unités graphiques et phoniques est un des attributs marquants du français: rares sont les cas de correspondance (ce sont essentiellement les consonnes prononcées). Le plus souvent, il y a soit absence de correspondance, soit (plus fréquemment) correspondance multiple. Le code écrit portugais, sans reposer sur une écriture purement phonétique ou phono-graphique, semble cependant plus proche du principe de correspondance bilatérale oral-écrit.
- Martinet (18) fait remarquer que le code oral et le code écrit, qui se correspondaient sans doute à un premier stade du français, ont vu leur correspondance troublée par l'évolution phonique de la langue, qui n'a pas été accompagnée d'une évolution correspondante du code graphique (surtout parce l'écrit est soucieux de préserver ses formes et de se perpétuer face aux dérivations de la langue parlée). Le décalage est tel aujourd'hui que le code graphique finit par assumer une certaine indépendance par rapport à la langue (19) En français, le code graphique bénéficie d'une large autonomie dans la mesure où il est assez distant des formes linguistiques correspondantes. L'exemple de la marque graphique du pluriel ("s"), dont la prononciation en français parlé est exceptionnelle (20), montre à quel point les deux codes reposent en dernière analyse sur des systèmes grammaticaux différents.
- L'ensemble de ces dissymétries est consigné par l'utilisation d'un système de transcription permettant de lever l'arbitraire de la prononciation, c'est-à-dire d'appliquer une correspondance stricte et objective entre une unité graphique et une unité phonique: c'est le principe de l'Alphabet Phonétique International (A.P.I.).
- L'etat actuel du système graphique du français l'exclut d'une utilisation descriptive de la réalité phonique de la langue. La graphie est, nous l'avons suggéré, très infidèle à la phonie: graphies muettes, graphies à prononciation multiple, prononciations à graphie multiple abondent en français.
- L'indépendance de la transcription phonétique par rapport au système graphique par le recours aux symboles de l'API nous fournit donc un point de départ pour comparer les systèmes phonologiques de la langue-source et de la langue-cible. L'API se fonde ainsi sur le principe de la bi-univocité: à chaque unité phonique correspond un seul segment graphique. L'ensemble de la transcription phonétique repose donc sur l'existence d'un ensemble de couples fixes son-lettre.(21)
-
- 1.1.La transcription phonétique du français