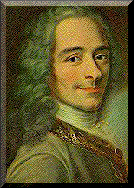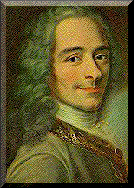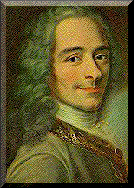
- Voltaire au Collège
Louis-le-Grand
-
- Extrait de la
Vie de Voltaire
- par
Desnoiresterres
-
-
- Voltaire, qui eût eu
besoin plus qu'un autre de la direction maternelle, perdit sa
mère à l'âge de sept ans. Madame Arouet
était jeune encore; elle avait environ quarante ans,
lorsqu'elle mourut, le 13 juillet 1704. La garde de cet
espiègle devait être chose embarrassante pour un
homme pris par les affaires; le payeur des épices, son
père, garda toutefois près de lui, durant trois
ans, le petit François-Marie, et ne l'envoya qu'en
octobre 1707 au collège des Jésuites. Son fils
aîné avait été mis au
séminaire de Saint-Magloire, dans le faubourg
Saint-Jacques; on se demande pourquoi il ne confia pas
également le dernier aux pères de l'Oratoire,
fort renommés, eux aussi, pour l'éducation. Sans
doute le fanatisme d'Armand avait déjà
percé, et l'en avait détourné. Voltaire
avait dix ans lorsqu'il entra au collège
Louis-le-Grand.
- Il eut pour recteur le
père Picard, auquel succédait, en 1705, le
père Letellier; et pour professeurs les pères
Porée, Lejay, Tournemine, Carteron. Le prix de la
pension était de quatre cents livres; mais il
s'élevait à plus pour ceux que ne satisfaisait
point le régime commun. Les fils de grands Seigneurs
voulaient être logés en grands seigneurs, avec un
précepteur et un valet attachés à leur
petite personne. Sans en tant exiger, les enfants des gens
aisés se contentaient de vivre par groupes de cinq
élèves, dans une chambre, sous la surveillance
d'un préfet. Ce fut ce régime mixte que choisit
M. Arouet. Le père Thoulié (l'abbé
d'Olivet), avant d'être le confrère à
l'Académie, fut le préfet de Voltaire, et tous
deux n'auront garde de l'oublier. « L'abbé d'Olivet
est un bon homme, écrit Voltaire à d'Alembert, et
je l'ai toujours aimé. D'ailleurs, il a
été mon préfet, dans le temps qu'il y
avait des jésuites,» et d'Olivet, de rappeler ces
temps lointains et de lui dire « Alors vous étiez
mon disciple, et aujourd'hui je suis le vôtre.
»
- A ces doux souvenirs se
mêle le souvenir charmant des mauvais jours
supportés en commun, le souvenir de l'hiver de 1709,
où pour avoir du pain bis, le jeune Arouet vit augmenter
sa pension de cent francs. Le froid fut horrible? et
préfet et élèves grelottaient à qui
mieux mieux au coin d'un méchant feu. L'épreuve
dut être rude pour le frileux poète qui,
dès la Saint-Jean, trouvait à propos de se
rapprocher de la cheminée. La première place, en
hiver, n'était pas le haut bout du banc, c'était
l'endroit le plus voisin du poèle; et Voltaire, que ses
compositions en éloignaient, jouait des coudes et des
mains pour se frayer un chemin jusqu'à ce centre
disputé. Cela donnait souvent lieu à des
discussions plus ou moins vives. Un jour qu'il s'était
laissé distancer, et que le poèle était
cerné comme une forteresse, il dit à un de ses
camarades plus jeune que lui: « Range-toi , sinon je
t'envoie chauffer chez Pluton. Que ne dis-tu en enfer?
répliqua celui-ci, il y fait encore plus chaud. - Bah!
l'un n'est pas plus sûr que l'autre. »
- Voilà une repartie
qui sent le fagot. Et cette autre que lui prête le
même historien. Au réfectoire, l'un de ses voisins
prétend qu'il lui a caché son verre; un tiers,
prenant parti pour le spolié, somme le ravisseur de
restituer le bien du prochain: « Arouet, rends-lui son
verre; tu es un taquin qui n'ira jamais au Ciel. - Tiens, que
dit-il avec son Ciel, s'écrie Arouet; le Ciel, c'est le
grand dortoir du monde. » Nous citons, et nous allons
citer les deux ou trois anecdotes relatives à son
séjour au collège Louis-le-Grand, tout en les
accueillant avec la défiance qu'elles méritent.
Jusqu'ici toutes les vies de Voltaire ont été des
thèses de parti, tantôt pour, tantôt contre
lui, où la vérité est le plus souvent
sacrifiée à la passion, au besoin de le produire
sous un tel ou tel jour. Il serait assez stérile de
grossir le groupe trop formidable de ces romans peu sûrs;
disons aussi que la vérité n'est pas toujours
aisée à démêler du faux. C'est
pourtant ce que nous devrons tenter, sauf à soumettre
nos doutes en absence de toute preuve décisive. Ces deux
manifestations d'une précoce impiété,
racontées plus haut, pourraient donc bien avoir
été inventées après coup; mais
elles ne sont pas les seules. Ainsi, le père Lejay,
à la suite de nous ne savons quelle répartie
malsonnante d'Arouet, descendait de chaire et lui sautait au
collet, en criant d'une voix terrible: « Malheureux! tu
seras un jour l'étendard du déisme en France!
» si le Pan était le seul à raconter ce
fait, on pourrait le révoquer en doute mais Duvernet et
Condorcet le rapportent bien avant le Pan, et le dernier ajoute
même, avec une complaisance marquée, que
«l'événement a justifié la
prophétie. »En tout cas, le mot du père
Lejay était bien solennel, adressé à un
bambin qu'il eût mieux valu traiter avec moins
d'importance. Il y avait dans l'apostrophe, quelque
sévère qu'elle voulût être, un
côté flatteur pour cet orgueil précoce que
le rôle de Satan ne devait pas épouvanter et
auquel, en quelque sorte, on montrait le chemin. Le mot de son
confesseur, le père Pallon « Cet enfant est
dévoré de la soif de la
célébrité! » eût dû
indiquer au père Lejay qu'il faisait fausse
route.
- Duvernet prétend
qu'il existait, d'ailleurs, entre le maître et
l'écolier, des raisons de ne pas s'aimer. Lejay, avec le
titre et les fonctions de professeur d'éloquence, avait
aussi peu d'éloquence qu'il est possible. Arouet
s'aperçut vite du défaut de la cuirasse, et
n'eût garde de n'en pas profiter dans les discussions
littéraires avec son régent, qui ne lui pardonna
point de l'avoir humilié. Le père Lejay semble
avoir été en butte à l'aversion des
élèves, qui luttaient d'invention pour lui jouer
quelque méchant tour. Le marquis d'Argenson raconte que
le duc de Boufflers et lui avaient tramé contre leur
régent de rhétorique « une manière de
révolte, » qui consistait à souffler par une
sarbacane de pois au nez du bon père. Cette
espièglerie fut traitée sur le pied d'un
véritable attentat, et il fut décidé que
les deux coupables passeraient par les verges. Notez que
d'Argenson avait dix-sept ans (1714), et que le petit duc de
Boufflers était alors gouverneur de Flandre en
survivance et colonel du régiment de son nom. Le premier
ne nous dit pas comment il esquiva le châtiment;
peut-être Lejay crut-il devoir l'épargner au fils
de celui à qui il avait dédié, en 1702, sa
tragédie latine de Damoclés; quant
à son complice, il le subit tout au long. Cette
exécution eut du retentissement, bien qu'elle ne
fût pas sans antécédents, même
à l'égard de grands garçons de cet
âge; le maréchal de Boufflers porta plainte au roi
et retira son fils qui, cruellement atteint par un affront peu
compatible avec sa dignité et son grade, mourait
quelques mois après de la petite vérole. Cette
terrible leçon ne profita point, et le régime des
verges n'en demeura pas moins en vigueur. Il est vrai que,
d'écoliers à cuistres, l'on ne jouait que trop
souvent des canifs, quand la résistance ne s'armait pas
plus sérieusement. Ainsi, plus tard, en 1723, au
collège des jésuites de La Flèche, les
pensionnaires prenaient fait et cause pour l'un des leurs qui,
menacé du fouet, tirait sur son régent qu'il
manquait, et abattait, d'un second coup, le grenadier
appelé pour le saisir. Ce n'est pas que ce mode de
répression n'eût été de vieille date
réprouvé par les esprits sensés, entre
autres, par le sage auteur des Essais dans son chapitre
de l'Institution des enfants.
- Comme on le voit, MM.
d'Argenson furent les condisciples de Voltaire. Ils
entrèrent au collège Louis-le-Grand à la
fin de 1709. L'aîné, qui était du
même âge que le poète philosophe, avait
quinze ans; c'était un peu tard pour commencer le
métier de collégien. « Nous étions
alors si grands garçons, raconte-t-il,
c'est-à-dire si avancés dans le monde, que, sans
être libertins, nous étions en chemin de le
devenir.» Ils avaient pour gouverneur un pauvre homme,
très peu propre à s'acquitter à son
honneur du difficile mandat dont leur père l'avait
chargé sans y trop regarder; et ce fut lorsqu'on
s'aperçut de l'impossibilité de le laisser
près d'eux davantage qu'on songea à
Louis-le-Grand. « J'en eus grande honte, » ajoute le
futur ministre des affaires étrangères. Et il y
avait bien de quoi: M. d'Argenson y était encore que le
petit duc de Fronsac qui avait deux ans de moins que lui,
épousait mademoiselle de Noailles, et se faisait mettre
à la Bastille pour avoir serré de trop
près la duchesse de Bourgogne. La conséquence de
toute position fausse est de rendre susceptible et farouche; du
plus loin qu'il apercevait un ancien ami ou quelques belles
dames de sa connaissance, il se sauvait pour n'avoir pas
à rougir. « Quelque temps après que je fus
au collège, dit-il encore, celui-ci (le prince de
Soubise) vint à une petite tragédie jouée
par des enfants dont il était parent, et moi
j'étais dans l'amphithéâtre, avec ma robe
et ma toque, sur un banc de bois: il m'avisa; je lui tournai le
dos. »
- Les choses avaient
été tout autrement pour le jeune Arouet;
entré de bonne heure aux Jésuites, il
était naturel qu'il y demeurât jusqu'au
complément de ses études, et le moment où
les deux survenants se voyaient si tardivement
séquestrés entre les quatre murailles d'un
collège, était celui où ses petits vers
lui ouvraient les portes de la plus illustre
société. Arouet se lia avec l'un et l'autre, et
resta leur ami. Le marquis, qu'il appelle «mon protecteur,
mon ancien camarade,» dit de lui «Voltaire, que j'ai
toujours fréquenté depuis le temps que nous avons
été ensemble au collège;» et cette
intimité était si bien avérée que,
dans une sortie contre l'aîné, le cardinal de
Fleury s'écriait: «Enfin, pour tout dire, c'est le
digne ami de Voltaire, et Voltaire son digne ami.» Quoique
moins dans la familiarité du cadet, le poète
avait conservé d'étroites relations avec ce
dernier, dont il fut même l'agent politique un moment
(1743-1747), comme cela ressort d'une de ses lettres. «On
m'a empaqueté pour Commerci, et j'y suis agonisant comme
à Paris. M'y voici avec le regret d'être
éloigné de vous, sans avoir pu profiter de votre
commerce délicieux et des bontés que vous avez
pour moi. Laissez-moi toujours, je vous prie,
l'espérance de passer les dernières années
de ma vie dans votre société. Il faut finir ses
jours comme on les a commencés. Il y a tantôt
quarante-cinq ans que je compte parmi vos attachés. Il
ne faut pas se séparer pour rien.» Et, plus tard
encore à Postdam: «Qui eût dit, lui
écrivait-il, dans le temps où nous étions
ensemble dans l'allée noire, qu'un jour je serais votre
historien, et que je le serais de si loin? » Qu'il se
cramponne à deux camarades d'études que le temps
a faits ministres l'un et l'autre, cela se conçoit. Mais
Voltaire ne fut pas moins chaud ami, moins ami sincère
avec tous. D'Argental sera pour lui plus qu'un frère. Et
Cideville! Quelle tendresse caressante et inépuisable
pour cet aimable et spirituel magistrat, avec lequel il
eût voulu passer sa vie, et que les circonstances tinrent
constamment éloigné de lui!
- Ce ne sont pas là
ses seuls camarades. Aux diverses étapes de sa vie il en
rencontra plus d'un sur sa route, et toujours avec une joie
véritable. Le Gouz de Guerland avait été
son camarade à Louis-le-Grand, ainsi que cet autre
Bourguignon, Fyot de la Marche, premier président du
parlement de Dijon, avec qui il échangeait, du
collège , des lettres charmantes, pleines de
gaieté, de sel, d'espiéglerie, et aussi d'une
amitié à laquelle se mêle presque le
respect. Ceux-là n'ont pas à se plaindre du sort.
Mais, parfois, le spectacle change; apparaît sur le seuil
de la porte une figure en linge sale, un menton de galoche, une
barbe de quatre doigts c'est le camarade Le Coq, qui
traîne sa misère de ville en ville. Et Voltaire de
s'attendrir, et sans doute de venir en aide au malheureux, bien
qu'il ne le dise point. Son affection ne semble pas moins
grande pour ses maîtres que pour ses condisciples.. Tous
ces souvenirs du collège restent, à quelque
âge de la vie que ce soit, pleins de charme et de
fraîcheur pour lui, et sa pensée reconnaissante
s'y arrête avec délices.
- « J'ai
été élevé pendant sept ans chez des
hommes qui se donnent des peines gratuites et infatigables
à former l'esprit et les moeurs de la jeunesse. Depuis
quand veut-on que l'on soit sans reconnaissance pour ses
maîtres? Quoi! il sera dans la nature de l'homme de
revoir avec plaisir une maison où l'on est né, le
village où l'on a été nourri par une femme
mercenaire, et il ne serait pas dans notre coeur d'aimer ceux
qui ont pris un soin généreux de nos
premières années? Si des jésuites ont un
procès au Malabar avec un capucin, pour des choses dont
je n'ai point connaissance, que m'importe? Est-ce une raison
pour moi d'être ingrat envers ceux qui m'ont
inspiré le goût des belles-lettres, et des
sentiments qui feront jusqu'au tombeau la consolation de ma
vie? Rien n'effacera dans mon coeur la mémoire du
père Porée, qui est également cher
à tous ceux qui ont étudié sous lui.
Jamais homme ne rendit l'étude et la vertu plus
aimables. Les heures de ses leçons étaient pour
nous des heures délicieuses; et j'aurais voulu qu'il
eût été établi dans Paris, comme
dans Athènes, qu'on pût assister à de
telles leçons; je serais revenu souvent les entendre.
J'ai eu le bonheur d'être formé par plus d'un
jésuite du caractère du père Porée,
et je sais qu'il a des successeurs dignes de lui. Enfin,
pendant les sept années que j'ai vécu dans leur
maison, qu'ai-je vu chez eux? La vie la plus laborieuse, la
plus frugale, la plus réglée; toutes leurs heures
partagées entre les soins qu'ils nous donnaient et les
exercices de leur profession austère. J'en atteste des
milliers d'hommes élevés par eux comme moi; il
n'y en aura pas un seul qui puisse me démentir....
»
- C'est le corps enseignant
dont Voltaire entend faire l'éloge. Sa reconnaissance
n'est pas telle qu'elle ne lui laisse ses coudées
franches et bien franches sur le reste; et, dans le
Dictionnaire philosophique, dans Candide,
à mille autres endroits, il ne sera sobre ni de
duretés ni de railleries à l'égard d'une
société qui avait le malheur de renfermer dans
son sein des pères Patouillet et des pères
Nonotte. Quoi qu'il en soit, on ne saurait être plus
tendre, plus affectueux qu'il ne le parut pour ses anciens
régents. il correspondit toujours avec eux, leur
témoignant, à l'occasion, un attachement et une
vénération qu'ils méritaient. Il
écrivait au père Tournemine, à
l'apparition de Mérope: "Mon très cher et
très révérend père, est-il vrai que
ma Mérope vous ait plu? Y avez-vous reconnu quelques-uns
de ces sentiments généreux que vous m'avez
inspirés dans mon enfance? si placet, tuum est:
c'est ce que je dis toujours en parlant de vous et du
père Porée...» A propos de cette même
Mérope, il disait à Thiériot, au
moment, il est vrai, de ses démêlés avec
l'abbé Desfontaines: "Au nom de Dieu, courez chez le
père Brumoy; voyez quelques-uns de ces pères, mes
anciens maîtres, qui ne doivent jamais être mes
ennemis. Parlez avec tendresse, avec force. Père Brumoy
a lu Mérope, il en est content; père
Tournemine en est enthousiasmé. Plût à Dieu
que je méritasse leurs éloges! Assurez-les de mon
attachement inviolable pour eux; je le leur dois, ils m'ont
élevé; c'est être un monstre que de ne pas
aimer ceux qui ont cultivé notre âme,» Quand
sa Henriade parut, il l'envoya au père
Porée avec une lettre charmante dont il faut au moins
citer le début: «Si vous vous souvenez encore, mon
révérend père, d'un homme qui se
souviendra de vous toute sa vie avec la plus tendre
reconnaissance et la plus parfaite estime, recevez cet ouvrage
avec quelque indulgence, et regardez moi comme un fils qui
vient, après plusieurs années, présenter
à son père le fruit de ses travaux dans un art
qu'il a appris autrefois sous lui... »
- Dans cette lettre, il
suppliait son respectable ami de vouloir bien l'instruire. S'il
avait parlé de la religion comme il le devait,
ambitionnant son estime non seulement comme auteur, mais comme
chrétien. Voilà qui vaut bien la peine qu'on le
remarque. Il écrivait cela en 1729; neuf ans
après, en 1738, dans la lettre à Tournemine,
citée plus haut, même prix attaché à
l'opinion de son ancien professeur, avec quelque chose de plus
encore « Si, dans quelques autres ouvrages qui sont
échappés à ma jeunesse (ce temps des
fautes), qui n'étaient pas faits pour être
publiés, que l'on a tronqués, que l'on a
falsifiés, que je n'ai jamais approuvés, il se
trouve des propositions dont on puisse se plaindre, ma
réponse sera bien courte; c'est que je suis près
d'en exclure sans miséricorde tout ce qui peut
scandaliser, quelque innocent qu'il soit dans le fond. Il ne
m'en coûte point de me corriger...»
- Sans doute, Voltaire est
peu sincère, quand il offre d'effacer ce qu'on peut
trouver de répréhensible dans ses oeuvres; sans
doute ces assurances n'étaient point à prendre au
pied de la lettre, et le père Tournemine, tout le
premier, en disant qu'il voudrait pouvoir le brider, formait un
souhait qu'il n'était pas dans ses moyens d'accomplir.
Mais ce sont au moins des marques de déférence
qui prouvent qu'il tient à ne pas rompre avec ces
directeurs affectueux et habiles de son enfance. Il sentait
qu'ils n'eussent pu décemment continuer, sans ces
garanties d'orthodoxie, un commerce d'amitié et de
lettres avec un écrivain assez mal famé
déjà, et il jugeait nécessaire de les
mettre à l'aise avec leur conscience et leurs
supérieurs, par des témoignages qu'ils pouvaient
produire au besoin. Ce n'est pas de la fausseté, si l'on
prend garde à l'époque où il écrit;
c'est de la prudence et de la courtoisie tout
ensemble.
- S'il s'était fait un
ennemi du père Lejay, Voltaire n'avait rencontré,
et il ne l'oublia jamais, qu'indulgence dans le père
Porée, qui tenait la classe du matin; car les deux
régents de rhétorique alternaient chaque
année: l'un professait l'éloquence le matin,
l'autre la poésie le soir. Ce dernier n'avait voulu voir
que les dons d'une nature prodigue qu'il fallait
façonner et diriger, et prenait plaisir à
développer cette intelligence pleine de promesses.
Malgré sa turbulence, le désir d'apprendre et de
connaître éloignait Arouet de ses petits camarades
et le rapprochait de ses maîtres. Dès sa
quatrième, il passait les récréations en
compagnie des pères Porée et Tournemine, avec
lesquels il donnait entière licence à cet
irrésistible besoin de questionner qu'ils
encourageaient. Et lui reprochait-on de ne pas danser, courir,
chanter, rire avec les autres; il répondait que chacun
sautait et s'amusait à sa manière. C'était
vers l'histoire, comme il le déclare dans une lettre
à l'abbé d'Olivet, et surtout l'histoire
contemporaine et les choses du gouvernement et de la politique,
qu'inclinait la curiosité de son esprit, ce qui faisait
dire à Porée: «qu'il aimait à peser
dans ses petites balances les grands intérêts de
l'Europe.»
- Mais, avant tout, il
était né pour faire des vers. Les vers avaient
été sa première langue, il avait
bégayé des vers avant d'articuler de la prose;
à trois ans, comme on l'a vu, Châteauneuf lui
faisait réciter les fables du bon la Fontaine et ce
poème irréligieux que Rousseau eût
composé lorsqu'il était secrétaire de
l'évêque de Viviers. Dès l'âge de
douze ans (en 1706), n'étant encore qu'en
cinquième, il s'essayait dans quelques traductions
d'Anacréon, qu'on n'a pas retrouvées, et une
épigramme imitée de l'anthologie grecque sur les
prouesses de Léandre, qui a été
recueillie. Mais le jeune Arouet avait, dès lors, de
bien autres visées, et son ambition ne tendait pas
à moins qu'à doter notre théâtre
d'un chef-d'oeuvre. C'est le rêve de tout
rhétoricien, mais il s'en fallait encore qu'il le
fût. Voltaire, plus tard, rencontrant, parmi d'autres
papiers, cet essai de collège, voulut le relire; mais il
fut vite rebuté et le jeta au feu sans nul remords.
Probablement ne fut-il que juste, ce qui ne nous empêche
pas de regretter cette exécution;il n'était pas
sans intérêt de le prendre à son point de
départ. En somme, deux fragments
échappèrent aux flammes et, après un
sommeil de cent quatorze ans, furent retrouvés par un
curieux; ils faisaient partie des manuscrits de Thiériot
et ont été publiés, en 1820, dans un
recueil de pièces inédites, où l'on peut
les aller chercher. Ce qui demeure incontestable, c'est sa
facilité, sa prestesse à rimer. Ses maîtres
prenaient plaisir à mettre à contribution sa muse
enfantine. Le petit Arouet, pour tuer l'heure, qui lui durait
trop, lançait un jour, pendant la classe, sa
tabatière en l'air et s'amusait à la recevoir au
retour. Le régent de la confisquer pour l'exemple.
Après la classe, l'étourdi alla la
réclamer; mais le coupable ne devait rentrer dans son
bien qu'en échange d'une supplique en beaux vers. Un
quart d'heure lui suffit pour rimer ses adieux à un
bijou qu'il se déclarait impuissant à
reconquérir à ce prix.
-
- Adieu, ma
pauvre tabatière!
- Adieu, je ne te
verrai plus;
- Ni soins, ni
larmes, ni prière
- Ne te rendront
à moi; mes efforts sont perdus.
- Adieu, ma
pauvre tabatière;
- Adieu, doux
fruit de mes écus!
- S'il faut
à prix d'argent te racheter
encore,
- J'irai
plutôt vider les trésors de
Plutus.
- Mais ce n'est
pas ce dieu que l'on veut que
j'implore,
- Pour te revoir,
hélas! il faut prier Phoebus...
- Qu'on oppose
entre nous une forte barrière!
- Me demander des
vers! hélas! je n'en puis plus.
- Adieu, ma
pauvre tabatière;
- Adieu, je ne te
verrai plus
Une autre fois, le
dernier-quart avant la fin de la classe, le père
Porée, surpris par l'heure et n'ayant plus le temps de
dicter le devoir pour le lendemain, dit aux
élèves de faire des vers sur la fin dramatique de
Néron succombant sous sa propre fureur. On a
conservé ceux d'Arouet.
- De la mort
d'une mère exécrable
complice,
- Si je meurs de
ma main, je l'ai bien
mérité;
- Et n'ayant
jamais fait qu'actes de cruauté,
- J'ai voulu, me
tuant, en faire un de justice.
Un invalide se
présente au collège Louis-le-Grand et s'adresse
à l'un des régents, au père Porée,
selon Luchet, pour obtenir une petite requête
rimée, qui pût intéresser à son sort
le Dauphin, dans le régiment duquel il avait servi. Le
régent, trop occupé ou peu soucieux de prendre
cette peine, lui répondit qu'il allait lui donner un mot
pour l'un de ses élèves, très capable de
le satisfaire. Cet élève c'était Arouet.
Au bout d'une demi-heure, le vieux soldat emportait ces vingt
vers:
- Noble sang du
plus grand des rois,
- Son amour et
son espérance,
- Vous qui, sans
régner sur la France,
- Régnez
sur le coeur des François,
- Pourrez-vous
souffrir que ma veirie,
- Par un effort
ambitieux,
- Ose vous donner
une étrenne,
- Vous qui n'en
recevez que de la main des dieux?
- La nature en
vous faisant naître,
- Vous
étrenna de ses plus doux
attraits
- Et fit voir
dans vos premiers traits
- Que le fils de
Louis était digne de
l'être.
- Tous les dieux
à l'envi vous firent leurs
présents
- Mars vous donna
la force et le courage;
- Minerve,
dès vos jeunes ans,
- Ajouta la
sagesse au feu bouillant de
l'âge;
- L'immortel
Apollon vous donna la beauté
- Mais un dieu
plus puissant, que j'implore en mes
peines
- Voulut me
donner mes étrennes,
- En vous donnant
la libéralité.
La petite requête en
vers obtint le résultat qu'on en attendait, en valant
quelques louis d'or à l'invalide. Elle valut encore
à Arouet un succès qui, cette fois, ne se borna
pas aux applaudissements de ses régents. On en parla
à Paris et à Versailles, et, s'il fallait en
croire le Commentaire historique, ce fut elle qui
inspira à Ninon l'envie de voir le précoce
auteur, ce fut à elle qu'il dut le souvenir charmant
qu'elle lui laissa par testament.
«L'abbé de
Châteauneuf me mena chez elle dans ma plus tendre
jeunesse. J'étais âgé d'environ treize ans.
J'avais fait quelques vers qui ne valaient rien, mais qui
paraissaient fort bien pour mon âge. Mademoiselle de
Lenclos avait autrefois connu ma mère, qui était
fort amie de l'abbé de Châteauneuf. Enfin, on
trouva plaisant de me mener chez elle. L'abbé
était le maître de la maison: c'était lui
qui avait fini l'histoire amoureuse de cette personne
singulière. C'était un de ces hommes qui n'ont
pas besoin de l'attrait de la jeunesse pour avoir des
désirs, et les charmes de la société de
mademoiselle de Lenclos avaient fait sur lui l'effet de la
beauté. Elle le fit languir deux ou trois jours; et
enfin l'abbé lui ayant demandé pourquoi elle lui
avait tenu rigueur si longtemps, elle lui répondit
qu'elle avait voulu attendre le jour de sa naissance pour ce
beau gala; et ce jour-là, elle avait juste soixante et
dix ans. Elle ne poussa guère plus loin cette
plaisanterie, et l'abbé de Châteauneuf resta son
ami intime. Pour moi, je lui fus présenté un peu
plus tard; elle avait quatre-vingt-cinq ans. Il lui plut de me
mettre sur son testament; elle me légua 2,000 francs
pour acheter des livres. Sa mort suivit de près ma
visite et son testament. »
L'histoire de ce dernier
caprice de la vieille Ninon est demeurée, de toutes ses
aventures, celle qui a le plus couru et qu'on s'est plu
davantage à répéter, bien qu'au fond cela
n'ait rien que de médiocrement souriant. D'abord est-on
bien sûr que ce ne soit pas là un conte
brodé à plaisir, comme on en a été
si prodigue à l'égard de la moderne
Léontium? Au moins y a-t-il plus d'une variante à
cette historiette. Châteauneuf a à disputer les
honneurs de cette dernière victoire à deux autres
personnages, tous deux de l'intimité de celle-ci, M. de
R*** (sans doute Rémond, introducteur des ambassadeurs)
et l'abbé Géd*** (Gédoyn). L'auteur de la
Vie de Mademoiselle de Lenclos ne parle nullement de
Châteauneuf, et, s'il écarte M. de R***, c'est au
profit de Gédoyn. En ce cas, au lieu de soixante-dix, ce
serait soixante-quatorze ans qu'aurait eus Ninon; car
Gédoyn ne lui fut présenté qu'à sa
sortie des jésuites, en 1694.
Mais on sait
désormais à quoi s'en tenir sur cette fable.
Depuis longtemps mademoiselle de Lenclos avait dit adieu
à toutes les charmantes faiblesses de l'amour; les amis
avaient remplacé les amants, son salon s'était
épuré, et les mères de famille lui
conduisaient leurs fils. Il ne faut que se souvenir de la
façon dont Saint-Simon, Madame de Coulonges, madame de
Sevigné, et Tallemant même parlent d'elle, pour
répudier un conte aussi ridicule qu'absurde. Quant
à Voltaire, qui ne faisait que répéter ce
qu'il avait entendu, il se contredit en plus d'un endroit et
rapporte les mêmes choses ailleurs d'une façon un
peu différente. S'il la gratifie plus haut de
soixante-dix ans, lors de ses amours avec Châteauneuf,
autre part il ne lui en donnera plus que soixante. C'est
pourtant quelque chose que dix ans de plus ou de moins à
tel âge et en telle affaire. Quand il la connut, Ninon
n'avait plus rien de ce reste d'attraits qui avaient
enflammé Châteauneuf; elle lui produisit l'effet
d'une momie. C'était, dit-il, dans la Défense
de mon Oncle, une décrépite ridée ,
qui n'avait sur les os qu'une peau jaune tirant sur le noir. Et
ailleurs «Je puis assurer qu'à l'âge de
quatre-vingts ans, son visage portait les marques les plus
hideuses de la vieillesse; que son corps en avait toutes les
infirmités... »
Il parle d'elle, en tous
cas, avec un ton dégagé qui, sans exclure la
reconnaissance pour le souvenir aimable de la bonne fille, ne
l'indique d'aucune sorte. Si on prenait à la lettre les
dates de Voltaire, il n'y aurait qu'à s'inscrire en
faux. Il ne peut pas avoir été
présenté à Ninon, à l'âge de
treize ans, puisqu'alors Ninon dormait depuis deux ans de son
dernier sommeil; mais il put l'avoir été à
onze, et bien qu'on nous dise qu'il bégaya ses premiers
vers en cinquième, par conséquent en 1706, rien
ne prouve qu'il n'ait pas rimé plus tôt. Pour le
legs de deux mille francs, force est bien d'en croire Voltaire
sur parole. Aprés tout, son père ne faisait-il
pas les affaires de Ninon, n'était-il pas son notaire?
Nous le voyons suivre sa dépouille mortelle à son
denier gîte, et l'acte de décès de la
spirituelle fille est signé de lui. Que Ninon ait
laissé à son ancien notaire, comme
témoignage de sa gratitude, une somme d'argent pour ce
bambin qui semblait déjà tant promettre,
c'était assez dans son caractère
généreux et désintéressé; et
le peu de concordance des dates n'est pas une raison, surtout
quand on connaît Voltaire, pour repousser un fait qui
n'est pas sans vraisemblance et qu'il n'a pas dû
complètement inventer.
Arouet, aux yeux de ses
maîtres et de ses condisciples, était bien un fils
d'Apollon; et il n'y avait pas à se méprendre sur
sa vraie vocation. Si le père Porée avait
introduit les vers français à Louis-le-Grand,
cela n'empêchait pas que l'on en fît de latins, et
que les vers latins, comme cela allait de droit, ne tinssent le
haut du pavé. Le père Lejay, qui s'exprimait si
mal dans sa langue, était, en revanche, fort
éloquent dans celle de Virgile et d'Horace. Il venait de
composer une ode sur sainte Geneviève; Arouet, soit pour
faire sa paix, soit que cela lui fût imposé
à titre de pensum, se mit a la traduire en onze
strophes, qui ne manquent ni de nombre ni de noblesse
même, et qui valent à coup sûr, comme forme
et mouvement, les trois quarts des odes de Lamotte. Une
circonstance assez piquante est que le futur auteur de la
Pucelle est amené, par les exigences de la
traduction, à mettre aux pieds de cette patronne de
Paris, dont son tombeau plus tard devait avoisiner la
châsse, la seule offrande qu'il lui pouvait faire, celle
de ses écrits:
- Les Indes pour
moi trop avares,
- Font couler
l'or en d'autres mains
- Je n'ai point
de ces meubles rares
- Qui flattent
l'orgueil des humains.
- Loin d'une
fortune opulente,
- Aux
trésors que je vous
présente
- Ma seule ardeur
donne du prix;
- Et si cette
ardeur peut vous plaire,
- Agréez
que j'ose vous faire
- Un hommage de
mes écrits.
Le hasard, qui a parfois de
ces rencontres, ne pouvait compromettre davantage et le
poète et la sainte qu'il célébrait. Bien
que publié en son temps par les jésuites, en
regard de l'ode latine du P. Lejay, ce premier essai lyrique
était demeuré depuis tellement ignoré, que
Fréron, en 1768, le reproduisait comme une pièce
rare et curieuse, dans une intention qu'on devine.
A part ce don des vers,
Arouet était un bon élève, un sujet
brillant, un collecteur de couronnes. A sa dernière
année de rhétorique, son nom plusieurs fois
acclamé frappa l'attention de Jean-Baptiste Rousseau,
qui assistait à la distribution des prix des
jésuites.
«Des dames de ma
connoissance, raconte ce dernier, m'avaient mené voir
une tragédie des jésuites, au mois d'août
de l'année 1710; à la distribution des prix, qui
se faisoit ordinairement après ces
représentations, je remarquai qu'on appela deux fois le
même écolier. Je demandai au père Ta***,
qui faisoit les honneurs de la chambre où nous
étions, qui étoit ce jeune homme si
distingué parmi ses camarades? Il me dit que
c'étoit un petit garçon qui avoit des
dispositions surprenantes pour la poésie, et me proposa
de me l'amener, à quoi je consentis. Il me l'alla
chercher, et je le vis revenir, un moment après, avec un
jeune écolier qui me parut avoir seize ou dix-sept ans,
d'une mauvaise physionomie, mais d'un regard vif et
éveillé, et qui vint m'embrasser de fort bonne
grace.... »
Tout cela est et doit
être vrai, et il n'y aurait rien à dire à
ce petit tableau sans ce trait où percent la
malveillance et l'inimitié «d'assez mauvaise
pbysionomie.» Mais Rousseau, à cette date,
n'était pas payé pour flatter l'original, avec
lequel il était en pleine guerre. Voltaire, qui
n'était pas homme à rien laisser tomber à
terre, dans une diatribe où, selon ses habitudes, il
dépassait la mesure de la juste et honnête
défense, ripostait aigrement: «Je ne sais pas
pourquoi il dit que ma physionomie lui
déplaît, c'est apparemment parce que j'ai des
cheveux bruns et que je n'ai pas la bouche de travers. »
L'auteur de la Henriade ne fait que défendre sa
figure; mais que penser des lignes suivantes:
«Il aurait dû
ajouter qu'il me fit cette visite parce que son père
avait chaussé le mien pendant vingt ans et que mon
père avait pris soin de le placer chez un procureur,
où il eût été à souhaiter
pour lui qu'il eût demeuré, mais dont il fut
chassé pour avoir désavoué sa naissance.
Il pouvait ajouter encore que mon père, tous mes
parents, et ceux sous qui j'étudiais, me
défendirent alors de le voir, et que telle était
sa réputation, que, quand un écolier faisait une
faute d'un certain genre, on lui disait - Vous serez un vrai
Rousseau. »
Voltaire ne pouvait parler
de Rousseau de sang-froid. «C'est là que l'homme
reste et que le héros s'évanouit, écrivait
de Cirey même madame de C**gny à un de ses amis;
il serait homme à ne point pardonner à quelqu'un
qui louerait Rousseau. » Il était capable des plus
affreux discours, et très capable même de calomnie
à l'égard de celui-ci, qui le lui rendait bien,
mais plus souterrainement. Il ne faudrait donc pas croire sans
contrôle ce qu'il dit plus haut, quoiqu'il y ait
déjà une énorme distance entre
l'allégation d'un fait mensonger et la couleur qu'on
peut donner à un fait vrai. Que Voltaire
répète ce mauvais bruit qui avait couru sur
Jean-Baptiste à propos d'une certaine reconnaissance
à la Comédie-Française, qu'il noircisse
ses moeurs et sa conduite; il brode plus ou moins sur un fond
réel ou réputé véritable. Mais M.
Arouet père a ou n'a pas fait entrer chez un procureur
le fils de son cordonnier, et vraiment il serait trop fort que
Voltaire eût inventé cela. Il prétend en
savoir long sur le lyrique, et ce ne sont pas là les
seules circonstances qui l'ont placé de façon
à être édifié sur sa
moralité. «La mère du petit malheureux qui
fut séduit pour déposer contre Saurin, servait
chez mon père» écrit-il dans une sorte de
factum adressé à un membre dc l'Académie
de Berlin. Au moins ce dernier fait est il avéré
et Suzanne Meusuier, dont le fils Guillaume fut convaincu dans
ces débats trop fameux de faux témoignage,
faisait-elle partie du domestique du père de Voltaire et
dépêchait-elle la grosse besogne de la
maison.
La vérité,
c'est que ses parents n'eurent pas comme il le donne à
entendre, à lui défendre de voir Rousseau, que
l'affaire des fameux couplets forçait de s'expatrier.
Nous sommes étonnés pourtant qu'il ne l'eût
pas rencontré antérieurement chez Chaulieu et
chez l'abbé Courtin. C'est vers 1706 que
Châteauneuf introduisit son protégé dans la
société du Temple. Mais Rousseau, nommé
peu après à un emploi de finances,
réalisait forcément les prédictions que
lui adressait Chaulieu. Il en était, d'ailleurs, aux
picoteries avec l'abbé Courtin, contre lequel il
décochait même une épigramme
méritée, il est vrai, par celui-ci, et tout cela
faisait sans doute qu'il fréquentait moins en ami.
Disons aussi qu'Arouet ne pouvait se montrer au Temple que les
jours de congé et durant les vacances, et que ce ne fut
qu'après sa sortie défnitive du collège
qu'il devint le familier de ces maisons auxquelles il allait
emprunter avec leur ton exquis, ce scepticisme, ce
dédain des choses les plus respectées et les plus
respectables, ce besoin de discussion, de révision qui
était dans l'air, mais dont il devait être
l'effrayante et formidable formule. Précisément
Rousseau, cédant à la tempête, succombant
sous le poids des charges, livrait alors le champ de bataille
à ses ennemis, trop cruellement offensés pour ne
pas être implacables, et demandait à l'exil un
repos qu'il ne devait rencontrer nulle part.
Arouet avait seize ans. Son
père, esprit positif, aimait les lettres, mais comme une
distraction, mais comme un délassement et une
récompense du travail, n'entendait pas que celui-ci fit
de la poésie sa principale affaire. Lorsqu'il fut
question du choix d'un état: «Je n'en veux pas
d'autre, s'écria le futur auteur de Zaïre,
que celui d'homme de lettres. - C'est, lui répondit
le payeur de la chambre des comptes, l'état d'un homme
qui veut être inutile à la société,
à charge à ses parents, et qui veut mourir de
faim; » et le poète fut envoyé aux
écoles de droit. Ce contraste entre les
élégances de la belle latinité, entre les
splendeurs de la langue de Corneille, de Racine, de Bossuet et
cet idiome barbare, ce jargon baroque, sous lequel la loi se
cachait comme si elle eût eu besoin de cette sorte d'aide
pour être le plus souvent inintelligible, était
bien fait pour rebuter un délicat, amoureux de
poésie et de beau langage. Il fut si choqué,
dit-il, en parlant de lui, dans son Commentaire historique,
de la manière dont on y enseignait la jurisprudence
(dans les écoles), et cela seul le tourna
entièrement du côté des belles-lettres. Il
faisait acte de présence, mais son esprit était
ailleurs. Sans être un homme, ce n'était plus un
enfant; à l'accueil qu'on lui faisait, il jugea vite de
sa valeur, et cette conviction lui donna dès lors un
aplomb que l'âge ne devait naturellement que faire
croître.
Les plus grands seigneurs
ne lui imposèrent guère, et les princes pas
davantage. On verra sur quel pied il était avec eux, et
avec quel sans-gêne escorté toujours d'un tact qui
corrigeait l'audace, il leur parlait. Bientôt il ne
bougea plus de chez Chaulieu, l'abbé Courtin,
l'abbé Servien, M. de Stilli. Ce n'est pas sans motifs
que nous omettons le nom du grand prieur. Duvernet, Condorcet
et les autres comptent, à cette heure, le chevalier de
Vendôme parmi les protecteurs d'Arouet. Au moins y a-t-il
anachronisme. Le grand prieur, forcé de s'exiler (mars
1706), à la suite de 1'affaire de Cassano, ne devait
plus reparaître à son grand prieuré qu'en
1715, et ce ne put être qu'à son retour,
amené par la mort de Louis XIV, que Voltaire lui fit sa
cour et sut conquérir les bonnes grâces de
l'altesse chansonnière.
Si de pareilles relations
avaient de quoi flatter l'amour-propre de M. Arouet, son bon
sens et sa prudence avaient tout autant lieu de s'alarmer de
ces amitiés illustres. Comment, en effet, cet enfant si
naturellement vain, n'eût-il pas perdu terre? Comment
exiger de lui, au sortir des hôtels de Boisboudrand et de
Sulli, après ces nuits passées dans l'orgie et
les débauches de l'esprit, qu'il prêtât une
oreille empressée et attentive au latin
pédantesque et plein de solécismes du professeur,
dans une salle qui avait tout l'aspect d'une grange, car alors
la jeunesse n'était pas gâtée, et ce
n'était point dans des palais qu'on lui déversait
la science?
On devait s'attendre
à bien des incartades, à bien des folies; on en
débitait de toutes les sortes, qu'on ne manquait pas
d'embellir, quand on ne les inventait pas absolument. Une
grande dame, qui faisait profession de bel esprit, l'avait
choisi pour corriger ses vers, pour en être le
teinturier, dirait-on de nos jours. Probablement,
s'acquitta-t-il de sa tache au grand contentement de la
duchesse; au moins celle-ci récompensa-t-elle son
collaborateur assez généreusement, par une bourse
de cent louis. Jamais il ne s'en était vu autant. Que
faire de cette fortune qui lui parut intarissable? En
traversant la rue Saint-Denis, ses regards se portent sur un
carrosse, des chevaux, des habits de livrée, qu'on
vendait à l'encan. Il achète tout, passe une
journée de délices traîné par ses
chevaux, qui le versaient à l'angle de la rue du
Long-Pont (une rue où il devait habiter et être
amoureux plus tard), mais sans lui faire le plus petit mal.
Après s'être montré à tous ses amis
dans cet attirail de prince, après avoir soupé en
ville, il fallait bien rentrer, et ce fut alors qu'il
s'aperçut de l'embarras des richesses. Il avait
payé des gens pour endosser sa livrée de
rencontre, il les congédia; mais que faire de la voiture
et des chevaux? Le concierge attacha en dehors le carrosse avec
une chaîne et mit les deux survenants à
l'écurie du payeur de la chambre des comptes,
écurie étroite qui n'était faite que pour
un cheval. On comprend dès lors la mauvaise humeur du
titulaire, forcé de partager avec deux intrus sa paille
et son avoine. Arouet est réveillé, à
trois heures du matin, par un tapage infernal; il s'informe de
la cause de ce sabbat, monte, furieux, dans la chambre de son
fils et le met à la porte de chez lui. Ce n'était
résoudre qu'une partie du problème: restaient les
chevaux, restait le carrosse. Le portier du palais les attelle,
et son jeune fils, appelé Fleurot, les mène chez
un charron, qui consent à en débarrasser le
poète à moitié prix. «Cette
espiéglerie, nous dit Paillet de Varcy, quoique
contestée par quelques partisans de l'auteur, n'en est
pas moins de toute vérité. »
Nous le voudrions d'autant
mieux qu'elle n'entache guère la réputation
d'Arouet, mais, en retranchant à l'anecdote ce qu'elle a
de manifestement inexact, nous ne voyons pas trop ce qu'il
reste. Voltaire ne pouvait avoir la pensée de faire
pénétrer sa voiture dans l'intérieur de la
cour où le payeur des épices n'avait pu trouver
place pour son équipage. Arouet, qui avait deux berlines
et un chariot, avait ses remises dans la maison de M. de la
Saullé au détour du palais, comme nous l'apprend
l'inventaire. Quant à l'écurie,...
 Last modified: 21-Mar-00
Last modified: 21-Mar-00