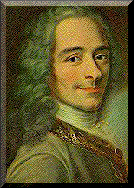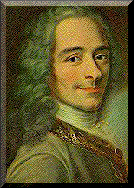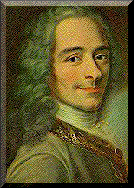
- Les
Droits Des Hommes
- Et
Les Usurpations Des Papes
-
- 1768
-
-
- Notice:Le
ministère français, pour justifier l'occupation
d'Avignon, avait fait imprimer les Recherches historiques
concernant les droits du pape sur la ville et l'État
d'Avignon, avec pièces justificatives, par C.-F.
Pfeffel, 1768, in-8°. Ce fut peut être ce qui donna
à Voltaire l'idée de composer son ouvrage dont
les Mémoires secrets parlent à la date du
9 octobre 1768. Il était alors intitulé les
Droits des hommes et les Usurpations des autres, traduit de
l'italien, in-8° de 48 pages. Une autre édition
de 1768, qui n'a que 47 pages, porte de plus ces mots: par
l'auteur de l'Homme aux quarante écus. Dans sa
lettre à Mme du Deffant, du 6 jantier 1769, Voltaire
l'intitule les Droits des uns et les Usurpations des autres.
Ce n'était pas là toute sa pensée,
qu'il ne cache plus dans sa lettre à
Frédéric, du 18octobre 1771. D'après cette
lettre on ne peut pas, ce me semble, hésiter à
rétablir le titre tel que je le donne. Pour la
commodité des lecteurs, j'ai numéroté les
paragraphes. ( .)
-
-
-
- I - UN
PRÊTRE DE CHRIST DOIT-IL ÊTRE
SOUVERAIN?
- Pour
connaître les droits du genre humain, on n'a pas besoin
de citations. Les temps sont passés où des
Grotius et des Puffendorf cherchaient le tien et le mien dans
Aristote et dans saint Jérôme, et prodiguaient les
contradictions et l'ennui pour connaître le juste et
l'injuste. Il faut aller au fait.
- Un
territoire dépend-il d'un autre territoire? Y-a-t-il
quelque loi physique qui fasse couler l'Euphrate au gré
de la Chine ou des Indes? Non, sans doute. Y a-t-il quelque
notion métaphysique qui soumette une île Moluque
à un marais formé par le Rhin et la Meuse ? il
n'y a pas d'apparence. Une loi morale? pas
davan-tage.
- D'où
vient que Gibraltar, dans la Méditerranée,
appartint autrefois aux Maures, et qu'il est aujourd'hui aux
Anglais, qui demeurent dans les îles de l'Océan,
dont les dernières sont vers le 60e degré? C'est
qu'ils ont pris Gibraltar. Pourquoi le gardent- ils? C'est
qu'on n'a pu le leur ôter; et alors on est convenu qu'il
leur resterait : la force et la convention donnent
l'empire.
- De quel
droit Charlemagne, né dans le pays barbare des
Austrasiens, dépouilla-t-il son beau-père, le
Lombard Didier, roi d'Italie, après avoir
dépouillé ses propres neveux de leur
héritage? Du droit que les Lombards avaient
exercé en venant des bords de la mer Baltique saccager
l'empire romain, et du droit que les Romains avaient eu de
ravager tous les autres pays l'un après l'autre. Dans le
vol à main armée, c'est le plus fort qui
l'emporte; dans les acquisitions convenues, c'est le plus
habile.
- Pour
gouverner de droit ses frères, les hommes (et quels
frères! quels faux frères!) que faut-il? Le
consentement libre des peuples.
- Charlemagne
vient à Rome, vers l'an 800, après avoir tout
préparé, tout concerté avec
l'évêque, et faisant marcher son armée, et
sa cassette dans laquelle étaient les présents
destinés à ce prêtre. Le peuple romain
nomme Charlemagne son maître, par reconnaissance de
l'avoir délivré de l'oppression
lombarde.
- A la bonne
heure que le sénat et le peuple aient dit à
Charles: « Nous vous remercions du bien que vous nous avez
fait; nous ne voulons plus obéir à des empereurs
imbéciles et méchants qui ne nous
défendent pas, qui n'entendent pas notre langue, qui
nous envoient leurs ordres en grec par des eunuques de
Constantinople, et qui prennent notre argent; gouvernez-nous
mieux, en conservant toutes nos prérogatives, et nous
vous obéirons. »
- Voilà
un beau droit, sans doute, et le plus
légitime.
- Mais ce
pauvre peuple ne pouvait assurément disposer de
l'empire: il ne l'avait pas; il ne pouvait disposer que de sa
per- sonne. Quelle province de l'empire aurait-il pu donner:
l'Espagne? elle était aux Arabes; la Gaule et
l'Allemagne? Pépin, père de Charlemagne, les
avait usurpées sur son maître; l'Italie
citérieure? Charles l'avait volée à son
beau-père. Les empereurs grecs possé daient tout
le reste; le peuple ne conférait donc qu'un nom : ce nom
était devenu sacré. Les nations, depuis
l'Euphrate jusqu'àl'Océan, s'étaient
accoutumées à regarder le brigandage du
saintempire romain comme un droit naturel; et la cour de
Constan tinople regarda toujours les démembrements de ce
saint empire comme une violation manifeste du droit des gens,
jusqu'à ce qu'enfin les Turcs vinrent leur apprendre un
autre code.
- Mais dire,
avec les avocats mercenaires de la cour pontificale romaine
(lesquels en rient eux-mêmes), que l'évêque
Léon III donna l'empire d'Occident à Charlemagne,
cela est aussi absurde que si on disait que le patriarche de
Constantinople donna l'empire d'Orient à Mahomet
II.
- D'un autre
côté, répéter après tant
d'autres que Pépin l'usurpateur, et Charlemagne le
dévastateur, donnèrent aux évêques
romains l'exarchat de Ravenne, c'est avancer une
fausseté évi-dente. Charlemagne n'était
pas si honnête. Il garda l'exarchat pour lui, ainsi que
Rome. Il nomme Rome et Ravenne, dans son testament, comme ses
villes principales. Il est constant qu'il confia le
gouvernement de Ravenne et de la Pentapole à un autre
Léon, archevêque de Ravenne, dont nous avons
encore la lettre, qui porte en termes exprès: Hae
civitates a Carolo ipso una cum universa Pentapoli mihi fuerunt
concessae.
- Quoi qu'il
en soit, il ne s'agit ici que de démontrer que c'est une
chose monstrueuse dans les principes de notre religion, comme
dans ceux de la politique et dans ceux de la raison, qu'un
prêtre donne l'empire, et qu'il ait des
souverainetés dans l'empire.
- Ou il faut
absolument renoncer au christianisme, ou il faut l'observer. Ni
un jésuite, avec ses distinctions, ni le diable n'y peut
trouver de milieu.
- Il se forme
dans la Galilée une religion toute fondée sur la
pauvreté, sur l'égalité, sur la haine
contre les richesses et les riches; une religion dans laquelle
il est dit qu'il est aussi impossible qu'un riche entre dans le
royaume des cieux qu'il est impossible qu'un chameau passe par
le trou d'une aiguille; où l'on dit que le mauvais riche
est damné uniquement pour avoir été riche;
où Ananias et Saphira sont punis de mort subite pour
avoir gardé de quoi vivre; où il est
ordonné aux disciples de ne jamais faire de provisions
pour le lendemain; où Jésus-Christ, fils de Dieu,
Dieu lui-même, prononce ces terribles oracles contre
l'am-bition et l'avarice: « Je ne suis pas venu pour
être servi , mais pour servir. Il n'y aura jamais parmi
vous ni premier ni der-nier. Que celui de vous qui voudra
s'agrandir soit abaissé. Que celui de vous qui voudra
être le premier soit le dernier. »
- La vie des
premiers disciples est conforme à ces préceptes;
saint Paul travaille de ses mains, saint Pierre gagne sa vie.
Quel rapport y a-t-il de cette institution avec le domaine de
Rome, de la Sabine, de l'Ombrie, de l'Émilie, de
Ferrare, de Ravenne, de la Pentapole, du Bolonais, de
Comacchio, de Bénévent, d'Avignon? On ne voit pas
que l'Évangile ait donné ces terres au pape,
à moins que l'Évangile ne ressemble à la
règle des théatins, dans laquelle il fut dit
qu'ils seraient vêtus de blanc, et on mit en marge:
c'est-à-dire de noir.
- Cette
grandeur des papes, et leurs prétentions mille fois plus
étendues, ne sont pas plus conformes à la
politique et à la raison qu'à la parole de Dieu,
puisqu'elles ont bouleversé l'Europe et fait couler des
flots de sang pendant Sept cents années.
- La politique
et la raison exigent, dans l'univers entier, que chacun jouisse
de son bien, et que tout État soit indépendant.
Voyons comment ces deux lois naturelles, contre lesquelles il
ne peut être de prescription, ont été
observées.
-
- II. - DE
NAPLES.
- Les
gentilshommes normands , qui furent les premiers instruments de
la conquête de Naples et de Sicile, firent le plus bel
exploit de chevalerie dont on ait jamais entendu parler.
Quarante à cinquante hommes seulement délivrent
Salerne au moment qu'elle est prise par une armée de
Sarrasins. Sept autres gentilshommes normands, tous
frères, suffisent pour chasser ces mêmes Sarrasins
de toute la contrée, et pour l'ôter à
l'empereur grec, qui les avait payés d'ingratitude. Il
est bien naturel que les peuples, dont ces héros avaient
ranimé la valeur, s'accoutumassent à leur
obéir par admiration et par reconnaissance.
- Voilà
les premiers droits à la couronne des Deux-Siciles. Les
évêques de Rome ne pouvaient pas plus donner ces
États en fief que le royaume de Boutan ou de Cachemire.
Ils ne pouvaient même en accorder l'investiture quand on
la leur aurait demandée: car dans le temps de l'anarchie
des fiefs, quand un seigneur voulait tenir son bien allodial en
fief pour avoir une protection, il ne pouvait s'adresser
qu'à son Seigneur suzerain. Or, certainement le pape
n'était pas seigneur suzerain de Naples, de la Pouille
et de la Calabre.
- On a
beaucoup écrit sur cette vassalité
prétendue; mais on n'a jamais remonté à la
source. J'ose dire que c'est le défaut de presque tous
les jurisconsultes comme de tous les théologiens. Chacun
tire, bien ou mal, d'un principe reçu les
conséquences les plus favorables à son parti;
mais ce principe est-il vrai? ce premier fait sur lequel ils
s'appuient est-il incontestable? c'est ce qu'ils se donnent
bien de garde d'examiner. Ils ressemblent à nos anciens
romanciers, qui supposaient tous que Francus avait
apporté en France le casque d'Hector. Ce casque
était impénétrable, sans doute; mais
Hector, en effet, l'avait-il porté? Le lait de la Vierge
est aussi très respectable; mais les sacristies qui se
vantent d'en posséder une roquille la
possèdent-elles en effet?
- Giannone est
le seul qui ait jeté quelque jour sur l'origine de la
domination suprême affectée par les papes sur le
royaume de Naples. Il a rendu en cela un service éternel
aux rois de ce pays, et, pour récompense, il a
été abandonné par l'empereur Charles VI,
alors roi de Naples, à la persécution des
jésuites; trahi depuis par la plus lâche des
perfidies, sacrifié à la cour de Rome, il a fini
sa vie dans la captivité . Son exemple ne nous
découragera pas. Nous écrivons dans un pays
libre; nous sommes nés libres, et nous ne craignons ni
l'ingratitude des souverains, ni les intrigues des
jésuites, ni la vengeance des papes. La
vérité est devant nous, et toute autre
considération nous est
étrangère.
- C'était
une coutume dans ces siècles de rapines, de guerres
particulières, de crimes, d'ignorance et de
superstition, qu'un seigneur faible, pour être à
l'abri de la rapacité de ses voisins, mît ses
terres sous la protection de l'Église, et achetât
cette protection pour quelque argent; moyen sans lequel on n'a
jamais réussi. Ses terres alors étaient
réputées sacrées: quiconque eût
voulu s'en emparer était excommunié.
- Les hommes
de ce temps-là, aussi méchants
qu'imbéciles, ne s'effrayaient pas des plus grands
crimes et redoutaient une excommunication, qui les rendait
exécrables aux peuples, encore plus méchants
qu'eux et beaucoup plus sots.
- Robert
Guiscard et Richard, vainqueurs de la Pouille et de la Calabre,
furent d'abord excommuniés par le pape Léon IX.
Ils s'étaient déclarés vassaux de
l'empereur; mais l'empereur Henri III, mécontent de ces
feudataires conquérants, avait engagé Léon
IX à lancer l'excommunication à la tête
d'une armée d'Allemands. Les Normands, qui ne
craignaient point ces foudres comme les princes d'Italie les
craignaient, battirent les Allemands et prirent le pape
prisonnier; mais, pour empêcher désormais les
empereurs et les papes de venir les troubler dans leurs
possessions, ils offrirent leurs conquêtes à
l'Église sous le nom d'oblata. C'est ainsi que
l'Angleterre avait payé le denier de Saint-Pierre; c'est
ainsi que les premiers rois d'Espagne et de Portugal, en
recou-vrant leurs États contre les Sarrasins, promirent
à l'Église de Rome deux livres d'or par an; ni
l'Angleterre, ni l'Espagne, ni le Portu-gal, ne
regardèrent jamais le pape comme leur seigneur
suzerain.
- Le duc
Robert, oblat de l'Église, ne fut pas non plus
feudataire du pape; il ne pouvait pas l'être, puisque les
papes n'étaient pas souverains de Rome. Cette ville
alors était gouvernée par son sénat:
l'évêque n'avait que du crédit; le pape
était à Rome précisément ce que
l'électeur est à Cologne. Il y a une
différence prodigieuse entre être oblat d'un
saint, et être feudataire d'un
évêque.
- Baronius,
dans ses Actes, rapporte l'hommage prétendu fait
par Robert, duc de la Pouille et de la Calabre, à
Nicolas II; mais cette pièce est fausse, on ne l'a
jamais vue, elle n'a jamais été dans aucune
archive. Robert s'intitula duc par la grâce de Dieu et
de saint Pierre; mais certainement saint Pierre ne lui
avait rien donné, et n'était point roi de Rome.
Si l'on voulait remonter plus haut, on prouverait
invinciblement, non seulement que saint Pierre n'a jamais
été évêque de Rome, dans un temps
où il est avéré qu'aucun prêtre
n'avait de siége particulier, et où la discipline
de l'Église naissante n'était pas encore
formée; mais que saint Pierre n'a pas plus
été à Rome qu'à Pékin. Saint
Paul déclare expressément que sa mission
était « pour les prépuces entiers, et que la
mission de saint Pierre était pour les prépuces
coupés »; c'est-à-dire que saint Pierre,
né en Galilée, ne devait prêcher que les
Juifs, et que lui Paul, né à Tarsus, dans la
Caramanie, devait prêcher les
étrangers.
- La fable qui
dit que Pierre vint à Rome sous le règne de
Néron, et y siégea pendant vingt-cinq ans, est
une des plus absurdes qu'on ait jamais inventées,
puisque Néron ne régna que treize ans. La
supposition qu'on a osé faire qu'une lettre de saint
Pierre, datée de Babylone, avait été
écrite dans Rome, et que Rome est là pour
Babylone, est une supposition si impertinente qu'on ne peut en
parler sans rire . On demande à tout lecteur
sensé ce que c'est qu'un droit fondé sur des
impostures si avérées.
- Enfin, que
Robert se soit donné à saint Pierre, ou aux douze
apôtres, ou aux douze patriarches, ou aux neuf choeurs
des anges cela ne communique aucun droit au pape sur un
royaume: ce n'est qu'un abus intolérable, contraire
à toutes les anciennes lois féodales, contraire
à la religion chrétienne, à
l'indépendance des souverains, au bon sens et à
la loi naturelle
- Cet abus a
sept cents ans d'antiquité: d'accord; mais en
eût-il sept cent mille, il faudrait l'abolir. Il y a eu,
je l'avoue, trente investitures du royaume de Naples
données par des papes; mais il y a eu beaucoup plus de
bulles qui soumettent les princes à la juridiction
ecclésiastique, et qui déclarent qu'aucun
souverain ne peut en aucun cas juger des clercs ou des moines,
ni tirer d'eux une obole pour le maintien de ses États:
il y a eu plus de bulles qui disent, de la part de Dieu, qu'on
ne peut faire un em-pereur sans le consentement du pape. Toutes
ces bulles sont tombées dans le mépris qu'elles
méritent; pourquoi respecterait-on davantage la
suzeraineté prétendue du royaume de Naples? Si
l'antiquité consacrait les erreurs, et les mettait hors
de toute atteinte, nous serions tous tenus d'aller à
Rome plaider nos procès lorsqu'il s'agirait d'un
mariage, d'un testament, d'une dîme; nous devrions payer
des taxes imposées par les légats; il faudrait
nous armer toutes les fois que le pape publierait une croisade;
nous achèterions à Rome des indulgences, nous
délivrerions les âmes des morts à prix
d'argent. nous croirions aux sorciers, à la magie, au
pouvoir des reliques sur les diables, chaque prêtre
pourrait envoyer des diables dans le corps des
hérétiques; tout prince qui aurait un
différend avec le pape perdrait sa souveraineté.
Tout cela est aussi ancien ou plus ancien que la
prétendue vassalité d'un royaume, qui, par sa
nature, doit être indé-pendant.
- Certes, si
les papes ont donné ce royaume, ils peuvent
l'ôter; ils en ont en effet dépouillé
autrefois les légitimes possesseurs. C'est une source
continuelle de guerres civiles. Ce droit du pape est donc en
effet contraire à la religion chrétienne,
à la saine politique, et à la raison: ce qui
était à démontrer.
-
- III.-DE
LA MONARCHIE DE SICILE.
- Ce qu'on
appelle le privilège, la prérogative de la
monarchie de Sicile, est un droit essentiellement
attaché à toutes les puissances
chrétiennes, à la république de
Gênes, à celles de Lucques et de Raguse, comme
à la France et à l'Espagne. Il consiste en trois
points principaux, accordés par le pape Urbain Il
à Roger, roi de Sicile:
Le
premier, de ne recevoir aucun légat a latere qui
fasse les fonctions de pape, sans le consentement du
souverain;
Le
second, de faire chez soi ce que cet ambassadeur
étranger s'arrogeait de
faire;
Le
troisième, d'envoyer aux conciles de Rome les
évêques et les abbés qu'il
voudrait.
- C'était
bien le moins qu'on pût faire pour un homme qui avait
délivré la Sicile du joug des Arabes, et qui
l'avait rendue chrétienne. Ce prétendu
privilége n'était autre chose que le droit
naturel, comme les libertés de l'Église gallicane
ne sont que l'ancien usage de toutes les
Églises.
- Ces
priviléges ne furent accordés par Urbain II,
confirmés et augmentés par quelques papes
suivants, que pour tâcher de faire un fief apostolique de
la Sicile, comme ils l'avaient fait de Naples; mais les rois ne
se laissèrent pas prendre à ce piège.
C'était bien assez d'oublier leur dignité
jusqu'à être vassaux en terre ferme; ils ne le
furent jamais dans l'île.
- Si l'on veut
savoir une des raisons pour laquelle ces rois se maintinrent
dans le droit de ne point recevoir de légat, dans le
temps que tous les autres souverains de l'Europe avaient la
faiblesse de les admettre, la voici dans Jean,
évêque de Salisbury: « Legati apostolici...
ita debacchantur in provinciis, ac Satan ad Ecclesiam
flagellandam a facie Domini. Provinciarum diripiunt spolia, ac
si thesauros Craesi studeant comparare. - Ils saccagent le
pays, comme si c'était Satan qui flagellât
l'Église loin de la face du Seigneur. Ils
enlèvent les dépouilles des provinces, comme
s'ils voulaient amasser les trésors de Crésus.
»
- Les papes se
repentirent bientôt d'avoir cédé aux rois
de Sicile un droit naturel: ils voulurent le reprendre.
Baronius soutint enfin que ce privilége était
subreptice, qu'il n'avait été vendu aux rois de
Sicile que par un antipape; et il ne fait nulle
difficulté de traiter de tyrans tous les rois
successeurs de Roger.
- Après
des siècles de contestations et d'une possession
toujours constante des rois, la cour de Rome crut enfin trouver
une occasion d'asservir la Sicile, quand le duc de Savoie,
Victor-Amédée, fut roi de cette île en
vertu des traités d'Utrecht.
- Il est bon
de savoir de quel prétexte la cour romaine moderne se
servit pour bouleverser ce royaume, si cher aux anciens
Romains. L'évêque de Lipari fit vendre un jour, en
1711, une dou-zaine de litrons de pois verts à un
grènetier. Le grènetier vendit ces pois au
marché, et paya trois oboles pour le droit imposé
sur les pois par le gouvernement. L'évêque
prétendit que c'était un sacrilége, que
ces pois lui appartenaient de droit divin, qu'ils ne devaient
rien payer a un tribunal profane. Il est évident qu'il
avait tort. Ces pois verts pouvaient être sacrés
quand ils lui appartenaient; mais ils ne l'étaient pas
après avoir été vendus.
L'évêque soutint qu'ils avaient un
caractère indélébile; il fit tant de
bruit, et il fut si bien secondé par ses chanoines,
qu'on rendit au grènetier ses trois oboles.
- Le
gouvernement crut l'affaire apaisée; mais
l'évêque de Lipari était déjà
parti pour Rome, après avoir excommunié le
gouverneur de l'île et les jurats. Le tribunal de la
monarchie leur donna l'absolution cum reincidentia;
c'est-à-dire qu'ils suspendirent la censure, selon le
droit qu'ils en avaient.
- La
congrégation qu'on appelle à Rome de
l'immunité envoya aussitôt une lettre
circulaire à tous les évêques siciliens,
laquelle déclarait que l'attentat du tribunal de la
monarchie était encore plus sacrilége que celui
d'avoir fait payer trois oboles pour des pois qui venaient
originairement du potager d'un évêque. Un
évêque de Catane publia cette déclaration.
Le vice-roi, avec le tribunal de la monarchie, la cassa, comme
attentatoire à l'auto-rité royale.
L'évêque de Catane excommunia un baron Figuerazzi
et deux autres officiers du tribunal.
- Le vice-roi,
indigné, envoya par deux gentilshommes un ordre à
l'évêque de Catane de sortir du royaume.
L'évêque excommunia les deux gentilshommes, mit
son diocèse en interdit, et partit pour Rome. On saisit
une partie de ses biens. L'évêque d'Agrigente fit
ce qu'il put pour s'attirer un pareil ordre; on le lui donna.
Il fit bien mieux que l'évêque de Catane; il
excommunia le vice-roi, le tribunal, et toute la
monarchie.
- Ces
pauvretés, qu'on ne peut lire aujourd'hui sans lever les
épaules, devinrent une affaire très
sérieuse. Cet évêque d'Agrigente avait
trois vicaires encore plus excommuniants que lui: ils furent
mis en prison. Toutes les dévotes prirent leur parti; la
Sicile était en combustion.
- Lorsque
Victor-Amédée, à qui Philippe V venait de
céder cette île, en prît possession, le 10
octobre 1713, à peine le nouveau roi était
arrivé que le pape Clément XI expédia
trois brefs à l'archevêque de Palerme par lesquels
il lui était ordonné d'excommunier tout le
royaume, sous peine d'être excommunié
lui-même. La Providence divine n'accorda pas sa
protection à ces trois brefs. La barque qui les
conduisait fit naufrage; et ces brefs, qu'un parlement de
France aurait fait brûler, furent noyés avec le
porteur. Mais comme la Providence ne se signale pas toujours
par des coups d'éclat, elle permit que d'autres brefs
arrivassent; un, entre autres, où le tribunal de la
monarchie était qualifié de certain
prétendu tribunal. Dès le mois de novembre,
la congrégation de l'immunité assembla tous les
procureurs des couvents de Sicile qui étaient à
Rome, et leur ordonna de mander à tous les moines qu'ils
eussent à observer l'interdit fulminé
précédemment par l'évêque de Catane,
et à s'abstenir de dire la messe jusqu'à nouvel
ordre.
- Le bon
Clément XI excommunia lui-même nommément le
juge de la monarchie, le 5 janvier 1714. Le cardinal Paulucci
ordonna à tous les évêques (et toujours
avec menace d'excommu-nication) de ne rien payer à
l'État de ce qu'ils s'étaient engagés
eux-mêmes à payer par les anciennes lois du
royaume. Le cardinal de La Trimouille, ambassadeur de France
à Rome, interposait la médiation de son
maître entre le Saint-Esprit et
Victor-Amédée; mais la négociation n'eut
point de succès.
- Enfin, le 10
février 1715, le pape crut abolir par une bulle le
tribunal de la monarchie sicilienne. Rien n'avilit plus une
autorité précaire que des excès qu'elle ne
peut soutenir. Le tribunal ne se tint point pour aboli; le
saint-père ordonna qu'on fermât toutes les
églises de l'île, et que personne ne priât
Dieu. On pria Dieu malgré lui dans plusieurs villes. Le
comte Maffei, envoyé de la part du roi au pape, eut une
audience de lui. Clément XI pleurait souvent, et se
dédisait aussi souvent des promesses qu'il avait faites.
On disait de lui « Il ressemble à saint Pierre, il
pleure et il renie. » Maffei, qui le trouva tout en larmes
de ce que la plupart des églises étaient encore
ouvertes en Sicile, lui dit: « Saint-Père, pleurez
quand on les fermera, et non quand on les ouvrira.
»
-
- IV. - DE
FERRARE .
- Si les
droits de la Sicile sont inébranlables, si la
suzeraineté de Naples n'est qu'une antique
chimère, l'invasion de Ferrare est une nouvelle
usurpation. Ferrare était constamment un fief de
l'empire, ainsi que Parme et Plaisance. Le pape Clément
VIII en dépouilla César d'Este, à main
armée, en 1597. Le prétexte de cette tyrannie
était bien singulier pour un homme qui se dit l'humble
vicaire de Jésus-Christ. Le duc Alfonse d'Este, premier
du nom, souverain de Ferrare, de Modène, d'Este, de
Carpi, de Rovigo, avait épousé une simple
citoyenne de Ferrare, nommée Laura Eustochia, dont il
avait eu trois enfants avant son mariage, re-connus par lui
solennellement en face d'église. Il ne manqua à
cette reconnaissance aucune des formalités prescrites
par les lois. Son successeur, Alfonse d'Este, fut reconnu duc
de Ferrare. Il épousa Julie d'Urbin, fille de
François, duc d'Urbin, dont il eut cet infortuné
César d'Este, héritier incontestable de tous les
biens de la maison, et déclaré héritier
par le dernier duc, mort le 27 octobre 1597. Le pape
Clément VIII, du nom d'Aldobrandin, originaire d'une
famille de négociants de Florence, osa prétexter
que la grand'mère de César d'Este n'était
pas assez noble, et que les enfants qu'elle avait mis au monde
devaient être regardés comme des bâtards.
Cette raison est ridicule et scandaleuse dans un
évêque; elle est insoutenable dans tous les
tribunaux de l'Europe d'ailleurs, si le duc n'était pas
légitime, il devait perdre Modène et ses autres
États; et s'il n'y avait point de vice dans sa
naissance, il devait garder Ferrare comme
Modène.
- L'acquisition
de Ferrare était trop belle pour que le pape ne
fît pas valoir toutes les décrétales et
toutes les décisions des braves théologiens qui
assurent que le pape peut rendre juste ce qui est injuste .
En conséquence, il excommunia d'abord César
d'Este; et comme l'excommunication prive nécessairement
un homme de tous ses biens, le père commun des
fidèles leva des troupes contre l'excommunié,
pour lui ravir son héritage, an nom de l'Église.
Ces troupes furent battues; mais le duc de Modène et de
Ferrare vit bientôt ses finances épuisées
et ses amis refroidis.
- Ce qu'il y
eut de plus déplorable, c'est que le roi de France Henri
IV se crut obligé de prendre le parti du pape, pour
balancer le crédit de Philippe II à la cour de
Rome. C'est ainsi que le bon roi Louis XII, moins excusable,
s'était déshonoré en s'unis-sant avec le
monstre Alexandre VI et son exécrable bâtard le
duc Borgia. Il fallut céder; alors le pape fit envahir
Ferrare par le cardinal Aldobrandin, qui entra dans cette
florissante ville avec mille chevaux et cinq mille
fantassins.
- Depuis ce
temps, Ferrare devint déserte; son terroir inculte se
couvrit de marais croupissants. Ce pays avait
été, sous la maison d'Este, un des plus beaux de
l'Italie; le peuple regretta toujours ses anciens
maîtres. Il est vrai que le duc fut
dédommagé. On lui donna la nomination à un
évêché et à une cure, et on lui
fournit même quelques minots de sel des magasins de
Cervia; mais il n'est pas moins vrai que la maison de
Modène a des droits incontestables et imprescriptibles
sur ce duché de Ferrare, dont elle est si indignement
dépouillée.
-
- V. - DE
CASTRO ET RONCIGLIONE.
- L'usurpation
de Castro et Ronciglione sur la maison de Parme n'est pas moins
injuste; mais la manière a été plus basse
et plus lâche . Il y a dans Rome beaucoup de juifs, qui
se vengent comme ils peuvent des chrétiens en leur
prêtant sur gages à gros intérêts.
Les papes ont été sur leur marché. Ils ont
établi des banques que l'on appelle
monts-de-piété: On y prête sur gages aussi,
mais avec un intérêt beaucoup moins fort. Les
particuliers y déposent leur argent, et cet argent est
prêté à ceux qui veulent emprunter, et qui
peuvent répondre.
- Rainuce, duc
de Parme, fils de ce célèbre Alexandre
Farnèse qui fit lever au roi Henri IV le siége de
Rouen et le siége de Paris, obligé d'emprunter de
grosses sommes, donna la préférence au
mont-de-piété sur les juifs. Il n'avait cependant
pas trop à se louer de la cour romaine. La
première fois qu'il y parut, Sixte-Quint voulut lui
faire couper le cou pour récompense des services que son
père avait rendus à l'Église.
- Son fils
Odoard devait les intérêts avec le capital, et ne
pouvait s'acquitter que difficilement. Barbarin ou Barberin,
qui était alors pape sous le nom d'Urbain VIII, voulut
accommoder l'affaire en mariant sa nièce Barbarini ou
Barbarina au jeune duc de Parme. Il avait deux neveux qui le
gouvernaient: l'un, Taddeo Barbarini, préfet de Rome; et
l'autre, le cardinal Antonio; et de plus un frère,
cardinal aussi, mais qui ne gouvernait per-sonne. Le duc alla
à Rome voir ce préfet et ces cardinaux, dont il
devait être le beau-frère moyennant une diminution
des intérêts qu'il devait au
mont-de-piété. Ni le marché, ni la
nièce du pape, ni les procédés des neveux
ne lui plurent il se brouilla avec eux pour la grande affaire
des Romains modernes, le punti-glia, la science du nombre des
pas qu'un cardinal et un préfet doivent faire en
reconduisant un duc de Parme. Tous les cauda-taires se
remuèrent dans Rome pour ce différend, et le duc
de Parme s'en alla épouser une
Médicis.
- Les
Barberins ou Barbarins songèrent à la vengeance.
Le duc vendait tous les ans son blé du duché de
Castro à la chambre des apôtres pour acquitter une
partie de sa dette, et la chambre des apôtres revendait
chèrement son blé au peuple. Elle en acheta
ailleurs, et défendit l'entrée du blé de
Castro dans Rome. Le duc de Parme ne put vendre son blé
aux Romains, et le vendit aussi ailleurs, comme il
put.
- Le pape, qui
d'ailleurs était un assez mauvais poète,
excom-munia Odoard selon l'usage, et incaméra le
duché de Castro. Incamérer est un mot de la
langue particulière à la chambre des
apôtres: chaque chambre a la sienne. Cela signifie
prendre, saisir, s'approprier, s'appliquer ce qui ne nous
appartient point du tout. Le duc, avec le secours des
Médicis et de, quelques amis, arma pour
désincamérer son bien. Les Barberins
armèrent aussi. On prétend que le cardinal
Antonio, en faisant délivrer des mousquetons
bénits aux soldats, les exhortait à les tenir
toujours bien propres, et à les rapporter dans le
même état qu'on les leur avait confiés. On
assure même qu'il y eut des coups donnés et
rendus, et que trois ou quatre personnes moururent dans cette
guerre, soit de l'intempérie, soit autrement. On ne
laissa pas de dépenser beaucoup plus que le blé
de Castro ne valait. Le duc fortifia Castro; et, tout
excommunié qu'il était, les Barberins ne purent
prendre sa ville avec leurs mousquetons. Tout cela ne
ressemblait que médiocrement aux guerres des Romains du
temps passé, et encore moins à la morale de
Jésus-Christ. Ce n'était pas même le
contrains-les d'entrer ; c'était le
contrains-les de sortir. Ce fracas dura, par
intervalles, pendant les années 1642 et 1643. La cour de
France, en 1644, procura une paix fourrée. Le duc de
Parme communia, et garda Castro.
- Pamphile,
Innocent X, qui ne faisait point de vers, et qui haïssait
les deux cardinaux Barberins, les vexa si durement pour les
punir de leurs vexations qu'ils s'enfuirent en France,
où le cardinal Antonio fut archevêque de Reims,
grand aumônier, et chargé d'abbayes.
- Nons
remarquerons en passant qu'il y avait encore un
troi-sième cardinal Barberin, baptisé aussi sons
le nom d'Antoine. Il était frère du pape Urbain
VIII. Celui-là ne se mêlait ni de vers ni de
gouvernement. Il avait été assez fou dans sa
jeunesse pour croire que le seul moyen de gagner le paradis
était d'être frère lai chez les capucins.
Il prit cette dignité, qui est assurément la
dernière de toutes; mais étant depuis devenu
sage, il se contenta d'être cardinal et très
riche. Il vécut en philosophe. L'épitaphe qu'il
ordonna qu'on gravât sur son tombeau est curieuse:
- Hic
jacet pulvis et cinis, postea nihil.
- Ci-gît
poudre et cendre, et puis rien.
- Ce
rien est quelque chose de singulier pour un
cardinal.
- Mais
revenons aux affaires de Parme. Pamphile, en 1646, voulut
donner à Castro un évêque fort
décrié pour ses moeurs, et qui fit trembler tous
les citoyens de Castro qui avaient de belles femmes et de jolis
enfants. L'évêque fut tué par un jaloux. Le
pape, au lieu de faire chercher les coupables, et de s'entendre
avec le duc pour les punir, envoya des troupes et fit raser la
ville. On attribua cette cruauté à dona Olimpia,
belle-soeur et maîtresse du pape, à qui le duc
avait eu la négligence de ne pas faire de
présents lorsqu'elle en recevait de tout le monde.
Démolir une ville était bien pis que de
l'incamérer. Le pape fit ériger une petite
pyramide sur les ruines, avec cette inscription: Qui fu
Castro.
- Cela se
passa sous Rainuce II, fils d'Odoard Farnèse. On
recommença la guerre, qui fut encore moins
meurtrière que celle des Barberins. Le duché de
Castro et de Ronciglione resta toujours confisqué au
profit de la chambre des apôtres, depuis 1646
jusqu'à 1662, sous le pontificat de Chigi, Alexandre
VII.
- Cet
Alexandre VII ayant, dans plus d'une affaire, bravé
Louis XIV, dont il méprisait la jeunesse et dont il ne
connaissait pas la hauteur, les différends furent
poussés si loin entre les deux cours, les
animosités furent si violentes entre le duc de
Créquy, ambassadeur de France à Rome, et Mano
Chigi, frère du pape, que les gardes corses de Sa
Sainteté tirèrent sur le carrosse de
l'ambassadrice, et tuèrent un de ses pages à la
portière . Il est vrai qu'ils n'y étaient
autorisés par aucune bulle; mais il parut que leur
zèle n'avait pas beaucoup déplu au
saint-père. Louis XIV fit craindre sa vengeance. Il fit
arrêter le nonce à Paris, envoya des troupes en
Italie, se saisit du comtat d'Avignon. Le pape, qui avait dit
d'abord que « des légions d'anges viendraient
à son secours », ne voyant point paraître ces
anges, s'humilia, demanda pardon. Le roi de France lui
pardonna, à condition qu'il rendrait Castro et
Ronciglione au duc de Parme, et Comacchio au duc de
Modène, tous deux attachés à ses
intérêts, et tous deux
opprimés.
- Comme
Innocent X avait fait ériger une petite pyramide en
mémoire de la démolition de Castro, le roi de
France exigea qu'on érigeât une pyramide du double
plus haute, à Rome, dans la place Farnèse,
où le crime des gardes du pape avait été
commis. A l'égard du page tué, il n'en fut pas
question. Le vicaire de Jésus-Christ devait bien au
moins une pension à la famille de ce jeune
chrétien. La cour de Rome fit habilement insérer
dans le traité qu'on ne rendrait Castro et Ronciglione
au duc que moyen-nant une somme d'argent équivalente
à peu près à la somme que la maison
Farnèse devait au mont-de-piété. Par ce
tour adroit, Castro et Ronciglione sont toujours
demeurés incamérès, malgré Louis
XIV, qui dans les occasions éclatait avec fierté
contre la cour de Rome, et ensuite lui
cédait.
- Il est
certain que la jouissance de ce duché a valu à la
chambre des apôtres quatre fois plus que le
mont-de-piété ne peut redemander de capital et
d'intérêts. N'importe, les apôtres sont
toujours en possession. Il n'y a jamais eu d'usurpation plus
manifeste. Qu'on s'en rapporte à tous les tribunaux de
judicature, depuis ceux de la Chine jusqu'à ceux de
Corfou: y en a-t-il un seul où le duc de Parme ne
gagnât sa cause? Ce n'est qu'un compte à faire.
Combien vous dois-je? combien avez-vous touché par vos
mains? Payez-moi l'excédant, et rendez-moi mon gage. Il
est à croire que quand le duc de Parme voudra intenter
ce procès, il le gagnera partout ailleurs qu'à la
chambre des apôtres.
-
- VI. -
ACQUISITIONS DE JULES II.
- Je ne
parlerai point ici de Comacchio; c'est une affaire qui regarde
l'empire, et je m'en rapporte à la chambre de Vetzlar et
au conseil aulique. Mais il faut voir par quelles bonnes
oeuvres les serviteurs des serviteurs de Dieu ont obtenu du
ciel tous les domaines qu'ils possèdent aujourd'hui.
Nous savons par le cardinal Bembo, par Guichardin, et par tant
d'autres, comment La Rovère, Jules II, acheta la tiare,
et comment il fut élu avant même que les cardinaux
fussent entrés dans le conclave. Il fallait payer ce
qu'il avait promis, sans quoi on lui aurait
représenté ses billets, et il risquait
d'être déposé. Pour payer les uns il
fallait prendre aux autres. Il commence par lever des troupes;
il se met à leur tête, assiége
Pérouse, qui appartenait au seigneur Baglioni, homme
faible et timide qui n'eut pas le courage de se
défendre. Il rendit sa ville en 1506. On lui laissa
seulement emporter ses meubles avec des agnus Dei. De
Pérouse Jules marche à Bologne, et en chasse les
Bentivoglio.
- On sait
comment il arma tous les souverains contre Venise, et comment
ensuite il s'unit avec les Vénitiens contre Louis XII.
Cruel ennemi, ami perfide, prêtre, soldat, il
réunissait tout ce qu'on reproche à ces deux
professions: la fourberie et l'inhumanité. Cet
honnête homme se mêlait aussi d'excommunier. Il
lança son ridicule foudre contre le roi de France Louis
XII, le père du peuple. Il croyait, dit un auteur
célèbre, mettre les rois sous l'ana-thème,
comme vicaire de Dieu; et il mettait à prix les
têtes de tous les Français en Italie, comme
vicaire du diable. Voilà l'homme dont les princes
baisaient les pieds, et que les peuples adoraient comme un
Dieu. J'ignore s'il eut la vérole, comme on l'a
écrit: tout ce que je sais, c'est que la signora Orsini,
sa fille, ne l'eut point, et qu'elle fut une très
honorable dame. Il faut toujours rendre justice au beau sexe
dans l'occasion.
-
- VII - DES
ACQUISITIONS D'ALEXANDRE VI.
- La terre a
retenti assez de la simonie qui valut à ce Borgia la
tiare, des excès de fureur et de débauche dont se
souillèrent ses bâtards, de son inceste avec
Lucrezia sa fille. Quelle Lucrezia! On sait qu'elle couchait
avec son frère et son père, et qu'elle avait des
évêques pour valets de chambre. On est assez
instruit du beau festin pendant lequel cinquante courtisanes
nues ramassaient des châtaignes en variant leurs
postures, pour amuser Sa Sainteté, qui distribua des
prix aux plus vigoureux vainqueurs de ces dames . L'Italie
parle encore du poison qu'on prétendit qu'il
prépara pour quelques cardinaux, et dont on croit qu'il
mourut lui-même . Il ne reste rien de ces
épouvantables horreurs que la mémoire; mais il
reste encore des héritiers de ceux que son fils et lui
assassinèrent, ou étranglèrent, ou
empoisonnèrent pour ravir leurs héritages. On
connaît le poison dont ils se servaient: il sappelait la
cantarella . Tous les crimes de cette abominable famille
sont aussi connus que l'Évangile, à l'abri duquel
ces monstres les commettaient impunément. Il ne s'agit
ici que des droits de plusieurs illustres maisons qui
subsistent encore. Les Orsini, les Colonne, souffriront-ils
toujours que la chambre apostolique leur retienne les
héritages de leur ancienne maison?
- Nous avons
à Venise des Tiepolo, qui descendent de la fille de Jean
Sforce, seigneur de Pesaro, que César Borgia chassa de
la ville au nom du pape son père Il y a des Manfredi qui
ont droit de réclamer Faenza. Astor Manfredi,
âgé de dix huit ans rendit Faenza au pape et se
remit entre les mains de son fils à condition qu'on le
laisserait jouir du reste de sa fortune. Il était d'une
extrême beauté, César Borgia en devint
éperdument amoureux; mais comme il était louche,
ainsi que tous ses portraits le témoignent, et que ses
crimes redoublaient encore l'horreur de Manfredi pour lui, ce
jeune homme s'emporta imprudemment contre le ravisseur: Borgia
n'en put jouir que par violence; ensuite il le fit jeter dans
le Tibre avec la femme d'un Caraccioli, qu'il avait
enlevée à son epoux.
- On a peine
à croire de telles atrocités; mais s'il est
quelque chose d'avéré dans l'histoire, ce sont
les crimes d'Alexandre VI et de sa famille.
- La maison de
Montefeltro n'est pas encore éteinte. Le duché
d'Urbin, qu'Alexandre VI et son fils envahirent par la perfidie
la plus noire et la plus célébrée dans les
livres de Machiavel, appar-tient à ceux qui sont
descendus de la maison de Montefeltro, à moins que les
crimes n'opèrent une prescription contre
l'équité.
- Jules
Varano, seigneur de Camerino, fut saisi par César Borgia
dans le temps même qu'il signait une capitulation, et fut
étranglé sur la place avec ses deux fils. Il y a
encore des Varano dans la Romagne: c'est à eux, sans
doute, que Camerino appar-tient.
- Tous ceux
qui lisent ont vu avec effroi, dans Machiavel, comment ce
César Borgia fit assassiner Vitellozzo Vitelli,
Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo, et Francesco Orsini, duc
de Gravina. Mais ce que Machiavel n'a point dit, et ce que les
historiens contemporains nous apprennent, c'est que, pendant
que Borgia faisait étrangler le duc de Gravina et ses
amis dans le château de Sinigaglia, le pape son
père faisait arrêter le cardinal Orsini, parent du
duc de Gravina, et confisquait tous les biens de cette illustre
maison. Le pape s'empara même de tout le mobilier. Il se
plaignit amèrement de ne point trouver parmi ces effets
une grosse perle estimée deux mille ducats, et une
cassette pleine d'or qu'il savait être chez le cardinal.
La mère de ce malheureux prélat,
âgée de quatre-vingts ans, craignant qu'Alexandre
VI, selon sa coutume, n'empoisonnât son fils, vint en
tremblant lui apporter la perle et la cassette mais son fils
était déjà empoisonné, et rendait
les derniers soupirs. Il est certain que si la perle est
encore, comme on le dit, dans le trésor des papes, ils
doivent en conscience la rendre à la maison des Ursins,
avec l'argent qui était dans la cassette.
-
- CONCLUSION.
- Après
avoir rapporté, dans la vérité la plus
exacte, tous ces faits, dont on peut tirer quelques
conséquences et dont on peut faire quelque usage
honnête, je ferai remarquer à tous les
inté-ressés qui pourront jeter les yeux sur ces
feuilles que les papes n'ont pas un pouce de terre en
souveraineté qui n'ait été acquis par des
troubles ou par des fraudes. A l'égard des troubles, il
n'y a qu'à lire l'histoire de l'empire et les
jurisconsultes d'Alle-magne. A l'égard des fraudes, il
n'y a qu'à jeter les yeux sur la donation de Constantin
et sur les dècrétales.
- La donation
de la comtesse Mathilde au doux et modeste Grégoire VII
est le titre le plus favorable aux évêques de
Rome. Mais, en bonne foi, si une femme à Paris, à
Vienne, à Madrid, à Lisbonne,
déshéritait tous ses parents, et laissait tous
ses fiefs masculins, par testament, à son confesseur,
avec ses bagues et joyaux, ce testament ne serait-il pas
cassé suivant les lois expresses de tous ces
États?
- On nous dira
que le pape est au-dessus de toutes les lois, qu'il peut rendre
juste ce qui est injuste : potest de injustitia facere
justitiam; papa est supra jus, contra jus, et extra jus;
c'est le sentiment de Bellarmin , c'est l'opinion des
théologiens romains. A cela nous n'avons rien à
répondre. Nous révérons le siège de
Rome; nous lui devons les indulgences, la faculté de
tirer des âmes du purgatoire, la permission
d'épouser nos belles-soeurs et nos nièces l'une
après l'autre, la canonisation de saint Ignace, la
sûreté d'aller en paradis en portant le scapulaire
; mais ces bienfaits ne sont peut-être pas une raison
pour retenir le bien d'autrui.
- Il y a des
gens qui disent que si chaque Église se gouvernait par
elle-même sous les lois de l'État; Si on mettait
fin à la simonie de payer des annates pour un
bénéfice; si un évêque, qui
d'ordinaire n'est pas riche avant sa nomination, n'était
pas obligé de se ruiner, lui ou ses créanciers,
en empruntant de l'argent pour payer ses bulles, l'État
ne serait pas appauvri, à la longue, par la sortie de
cet argent qui ne revient plus. Mais nous laissons cette
matière à discuter par les banquiers en cour de
Rome.
- Finissons
par supplier encore le lecteur chrétien et
bénévole de lire l'Évangile, et de voir
s'il y trouvera un seul mot qui ordonne le moindre des tours
que nous avons fidélement rapportés. Nous y
lisons, il est vrai, « qu'il faut se faire des amis avec
l'argent de la mammone d'iniquité ». Ah!
beatissimo padre, si cela est, rendez donc
l'argent.
- A
Padoue, 24 juin 1765.
 Last modified: 21-Mar-00
Last modified: 21-Mar-00