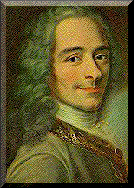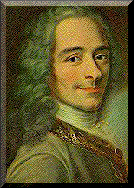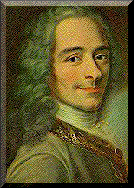
- Le
dossier de
- L'AFFAIRE
CALAS
-
-
-
- NOTICE:
C'est dans la lettre à d'Argental, du 5 juillet
1762, que Voltaire parle pour la première fois des
Pièces originales, se composant de l'Extrait
d'une lettre de la dame veuve Calas, et de la Lettre de
Donat Calas. Elles formaient, dans la première
édition, vingt-deux pages in-8°. Elles avaient
été rédigéés par Voltaire
d'après les renseignements donnés par les
personnes qui les ont signées.
- Ce fut
Audibert (Dominique), depuis secrétaire de
l'Académie de Marseille, et mort à
Saint-Germain-en-Laye le 10 août 1821, qui, le premier,
parla des Calas à Voltaire; voyez la lettre du 13
décembre 1763. Les écrits de Voltaire relatifs
aux Calas, qu'on trouvera ci-après, sont, outre les
Pièces originales:
- 1° une
supplique A monseigneur le chancelier
- 2°
Requête au Roi;
- 3°
Mémoire de Donat Calas (et Déclaration
de P. Calas);
- 4°
Histoire d'Élisabeth Canning et de Jean Calas.
C'est pour la révision de ce procès que
Voltaire composa son Traité sur la Tolérance.
Beaucoup de ses lettres prouvent avec quelle chaleur il
avait embrassé cette cause. La lettre à
Damilaville, du 1er mars 1765, imprimée dans le temps, a
été, par les éditeurs de Kehl, mise
à côté des ouvrages dont je viens de
parler; mais je l'ai placée dans la Correspondance,
à sa date. C'est à son ordre chronologique que
j'ai placé l'Avis au public sur les parricides
imputés aux Calas et aux Sirven.
- Voici une
liste d'écrits sur les Calas
- I.Déclaration
du sieur Louis Calas (2 décembre 1761), in-8°
de cinq pages.
- II.Mémoire
pour le sieur J. Calas, négociant de cette ville, dame
Anne-Rose Cabibel, son épouse, et le sieur J.-P. Calas,
un de leurs enfants (par Sudre), in-8° de cent quatre
pages.
- III.Observations
pour le sieur J. Calas, la dame de Cabibel, son épouse,
et le sieur P. Galas, leur fils (par Duroux, 1762,
in-8° de soixante et douze pages.
- IV.Mémoire
à consulter, et Consultation pour la dame Anne-Rose
Cabibel, veuve Calas, et Pour ses enfants, in-8° de
soixante et onze pages, daté du 23 août 1762,
signé par Élie de Beaumont et quinze autres
avocats.
- V.Mémoire
pour dame Anne-Rose Cabibel, veuve du sieur Jean Calas; L. et
L.-D. Calas, leurs fils, et Anne-Rose et Anne Calas, leurs
filles, demandeurs en cassation d'un arrêt du parlement
de Toulouse, du 9 mars 1762, in-8° de cent trente-six
pages.
- VI.Mémoire
pour Donat, Pierre, et Louis Calas, 1762, in-8° de
soixante-trois pages, signé Loyseau de
Manléon.
- VII.Mémoire
du sieur Gaubert Lavaysse, de vingt-six pages.
- VIII.Mémoire
de Me David Levaysse, avocat en la cour, pour le sieur
François-Alexandre-Gaubert Lavaysse, son fils, de
cinquante-deux pages.
- IX.Mémoire
du sieur F.-A.-G. Lavaysse, de trente-deux
pages.
- X.Mémoire
sur une question anatomique, retative à la
jurisprudence, dans lequel on établit les principes pour
distinguer, à l'inspection d'un corps trouvé
pendu, les signes du suicide d'avec ceux de l'assassinat, par
M. Louis, Paris, Cavalier, 1763, in-8° de cinquante
quatre pages.
- XI.Observations
pour la dame veuve Calas et sa famille, 1764, in-8° de
vingt-neuf pages, signé Manette.
- XII.Mémoire
à consulter, et Consultation pour les enfants de
défunt J. Calas, Paris, Merlin, 1765, in-8°,
signé de huit avocats : Mallard, d'Outremont, Manette,
Gerbier, Legouvé, Loyseau de Mauléon, Élie
de Beaumont.
- MII.
Mémoire pour dame Anne-Rose Cabibel, veuve Calas, et
pour ses enfants, 1765, in-8° de quatre-vingt-quatorze
pages, d'Élie de Beaumont.
- XIV.Mémoire
pour la veuve Calas et sa famille, 1765, in-8° de
cinquante-trois pages, signé Manette,
- XV.Jugement
souverain des requêtes ordinaires de l'hôtel du
roi, qui décharge Anne-Rose Cabibel, veuve de Jean
Calas, Jean P. Calas, Jeanne Wiguiére, Alexandre
François-Gualbert Lavaysse, et la mémoire dudit
défunt Jean Calas, de l'accusation contre eux
intentée; du 9 mars 1767, in-8° de trente-neuf
pages.
- XVI.Les
Toulousaines, ou Lettres historiques et apologétiques en
faveur de le religion réformée et de divers
protestants condamnés dans ces derniers temps par le
parlement de Toulouse ou dans le Haut-Languedoc.
Édimbourg, 1763, in-12 de viij et quatre cent
cinquante-neuf pages
- XVII.Requête
au roi pour la dame veuve Calas, 1763, in-8°, de huit
pages, en vers.
- XVIII.Calas
sur l'échafaud à ses juges, 1763, in-8°
de huit pages, en vers.
- XIX.Lettre
d'un cosmopolite à l'ombre de Calas, 1765,
in-8° de huit pages, en vers libres.
- XXI.Histoire
des malheurs de la famille des Calas, etc., (par E -T. si
mon), 4765, in-8'.
- XXII.Jean
Calas à sa femme et à ses enfants, par Blin,
1765, in-8' de vingt-cinq pages
- XXIII.Premier
Sermon sur le mort de Jean Calas, vieillard infirme,
accusé, par les bons catholiques, d'avoir pendu son
fils, jeune homme le plus adroit, le plus fort et le plus
robuste de la province (dans les Sermons prêchés
à Toulouse devant Messieurs du parlement et du
capitoulat, par le R. P. Apompée de Tragopone, capucin
de la Champagne-Pouilleuse, 1772, in-4°).
- M.J.
Chénier, Lemiére d'Argy, et M. Laya, ont
donné chacun un drame intitulé Calas. Ces
trois pièces ont été jouées et
imprimées on 1790 et 1791. La veuve Calas à
Paris, jouée et imprimée en 1791, est de
Pujouix. M. Victor Ducange a donné, on 1820, au
théatre de l'Ambigu-Comique, un mélodrame
intitulé Calas. On a imprimé à
Berlin les Calas, drame en trois actes et en prose, 1778.
(B.)
-
-
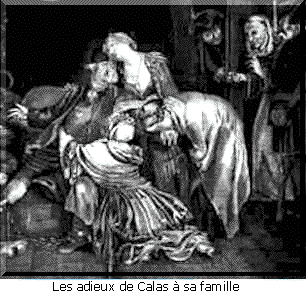
-
-
- EXTRAIT
- D'UNE
LETTRE DE LA DAME VEUVE CALAS.
- Du 15 juin
1762.
- Non,
monsieur, il n'y a rien que je ne fasse pour prouver notre
innocence, préférant de mourir justifiée
à vivre et à être crue coupable. On
continue d'opprimer l'innocence, et d'exercer sur nous et notre
déplorable famille une cruelle persécution. On
vient encore de me faire enlever, comme vous le savez, mes
chères filles, seuls restes de ma consolation, pour les
conduire dans deux différents couvents de Toulouse: on
les mène dans le lieu qui a servi de
théâtre à tous nos affreux malheurs; on les
a même séparées. Mais si le roi daigne
ordonner qu'on ait soin d'elles, je n'ai qu'à le
bénir. Voici exactement le détail de notre
malheureuse affaire, tout comme elle s'est passée au
vrai.
- Le 13
octobre 1761, jour infortuné pour nous, M. Gobert
Lavaisse, arrivé de Bordeaux (où il était
resté quelque temps) pour voir ses parents, qui
étaient pour lors à leur campagne, et cherchant
un cheval de louage pour les y aller joindre sur les quatre
à cinq heures du soir, vient à la maison; et mon
mari lui dit que, puisqu'il ne partait pas, s'il voulait souper
avec nous il nous ferait plaisir; à quoi le jeune homme
consentit, et il monta me voir dans ma chambre, d'où,
contre mon ordinaire, je n'étais pas sortie. Le premier
compliment fait, il me dit: «Je soupe avec vous, votre
mari m'en a prié.» Je lui en témoignai ma
satisfaction, et le quittai quelques moments pour aller donner
des ordres à ma servante. En conséquence je fus
aussi trouver mon fils a»né, Marc-Antoine, que je
trouvai assis tout seul dans la boutique, et fort rêveur,
pour le prier d'aller acheter du fromage de
Roquefort.
- Il
était ordinairement le pourvoyeur pour cela, parce qu'il
s'y connaissait mieux que les autres; je lui dis donc:
«Tiens, va acheter du fromage de Roquefort, voilà
de l'argent pour cela, et tu rendras le reste à ton
père»; et je retourne dans ma chambre joindre le
jeune homme Lavaisse, que j'y avais laissé. Mais peu
d'instants après il me quitta, disant qu'il voulait
retourner chez les fenassiers (Ce sont les loueurs de chevaux.
Note de Voltaire.) voir s'il y avait quelque cheval
d'arrivé, voulant absolument partir le lendemain pour la
campagne de son père; et il sortit.
- Lorsque mon
fils a»né eut fait l'emplette du fromage, l'heure
du souper arrivée, (Sur les sept heures. Note de
Voltaire.), tout le monde se rendit pour se mettre à
table, et nous nous y plaçâmes. Durant le souper,
qui ne fut pas fort long, on s'entretint de choses
indifférentes, et entre autres des antiquités de
l'hôtel de ville; et mon cadet, Pierre, voulut en citer
quelques-unes, et son frère le reprit, parce qu'il ne
les racontait pas bien ni juste.
- Lorsque nous
fumes au dessert, ce malheureux enfant, je veux dire mon fils
a»né Marc-Antoine, se leva de table, comme
c'était sa coutume, et passa à la cuisine (La
cuisine est auprès de la salle à manger, au
premier étage. Note de Voltaire.). La servante lui
dit:
- -Avez-vous
froid, monsieur l'a»né? chauffez-vous.» Il lui
répondit: «Bien au contraire, je brûle et
sortit. Nous restâmes encore quelques moments à
table; après quoi nous passâmes dans cette chambre
que vous connaissez, et où vous avez couché (On
voit par cette phrase que la lettre est adressée
à un des deux négociants dont Voltaire parle dans
la Correspondance,Note de ). M. Lavaisse, mon mari, mon fils,
et moi; les deux premiers se mirent sur le sofa, mon cadet sur
un fauteuil, et moi sur une chaise, et là nous
f»mes la conversation tous ensemble. Mon fils cadet
s'endormit; et environ sur les neuf heures trois quarts
à dix heures, M. Lavaisse prit congé de nous, et
nous réveillâmes mon cadet pour aller accompagner
ledit Lavaisse, lui remettant le flambeau à la main pour
lui faire lumière; et ils descendirent
ensemble.
- Mais
lorsqu'ils furent en bas, l'instant d'après nous
entend»mes de grands cris d'alarme, sans distinguer ce que
l'on disait, auxquels mon mari accourut, et moi, je demeurai
tremblante sur la galerie, n'osant descendre, et ne sachant pas
ce que ce pouvait être.
- Cependant,
ne voyant personne venir, je me déterminai de descendre
ce que je fis; mais je trouvai au bas de l'escalier M.
Lavaisse, à qui je demandai avec précipitation
qu'est-ce qu'il y avait. Il me répondit qu'il me
suppliait de remonter, que je le saurais; et il me fit tant
d'instances que je remontai avec lui dans ma chambre. Sans
doute que c'était pour m'épargner la douleur de
voir mon fils dans cet état, et il redescendit; mais
l'incertitude où j'étais était un
état trop violent pour pouvoir y rester longtemps;
j'appelle donc ma servante, et lui dis: «Jeannette, allez
voir ce qu'il y a là-bas; je ne sais pas ce que c'est,
je suis toute tremblante»; etje lui mis la chandelle
à la main, et elle descendit; mais, ne la voyant pas
remonter pour me rendre compte, je descendis moi-même.
Mais grand Dieu! quelle fut ma douleur et ma surprise, lorsque
je vis ce cher fils étendu à terre! Cependant je
ne le crus pas mort, et je courus chercher de l'eau de la reine
d'Hongrie, croyant qu'il se trouvait mal; et comme
l'espérance est ce qui nous quitte le dernier, je lui
donnai tous les secours qu'il m'était possible pour le
rappeler à la vie, ne pouvant me persuader qu'il
fût mort. Nous nous en flattions tous, puisque l'on avait
été chercher le chirurgien, et qu'il était
auprès de moi, sans que je l'eusse vu ni aperçu
que lorsqu'il me dit qu'il était inutile de lui faire
rien de plus, qu'il était mort. Je lui soutins alors que
cela ne se pouvait pas, et je le priai de redoubler ses
attentions et de l'examiner plus exactement, ce qu'il fit
inutilement. Cela n'était que trop vrai; et pendant tout
ce temps-là mon mari était appuyé sur un
comptoir à se désespérer: de sorte que mon
coeur était déchiré entre le
déplorable spectacle de mon fils mort, et la crainte de
perdre ce cher mari, de la douleur à laquelle il se
livrait tout entier sans entendre aucune consolation; et ce fut
dans cet état que la justice nous trouva, lorsqu'elle
nous arrêta dans notre chambre où l'on nous avait
fait remonter.
- Voilà
l'affaire tout comme elle s'est passée, mot à
mot; et je prie Dieu, qui conna»t notre innocence, de me
punir éternellement si j'ai augmenté ni
diminué d'un iota, et si je n'ai dit la pure
vérité en toutes ses circonstances. Je suis
prête à sceller de mon sang cette
vérité.
-
-
-
- LETTRE
- DE
DONAT CALAS FILS A LA DAME VEUVE CALAS, SA
MÈRE.
- De
Chatelaine, 22 juin 1762.
- Ma
chère, infortunée et respectable mère,
j'ai vu votre lettre du 15 juin entre les mains d'un ami qui
pleurait en la lisant (c'est Voltaire.); je l'ai
mouillée de mes larmes. Je suis tombé à
genoux; j'ai prié Dieu de m'exterminer si aucun de ma
famille était coupable de l'abominable parricide
imputé à mon père, à mon
frère, et dans lequel vous, la meilleure et la plus
vertueuse des mères, avez été
impliquée vous-même.
- Obligé
d'aller en Suisse depuis quelques mois pour mon petit commerce,
c'est là que j'appris le désastre inconcevable de
ma famille entière. Je sus d'abord que vous ma
mère, mon père, mon frère Pierre Calas, M.
Lavaisse, jeune homme connu pour sa probité et pour la
douceur de ses moeurs, vous étiez tous aux fers à
Toulouse; que mon frère a»né, Marc-Antoine
Calas, était mort d'une mort affreuse, et que la haine,
qui na»t si souvent de la diversité des religions,
vous accusait tous de ce meurtre. Je tombai malade dans
l'excès de ma douleur, et j'aurais voulu être
mort.
- On m'apprit
bientôt qu'une partie de la populace de Toulouse avait
crié à notre porte en voyant mon frère
expiré: «C'est son père, c'est sa famille
protestante qui l'a assassiné; il voulait se faire
catholique (*), il devait abjurer le lendemain; son père
l'a étranglé de ses mains, croyant faire une
oeuvre agréable à Dieu; il a été
assisté dans ce sacrifice par son fils Pierre, par sa
femme, par le jeune Lavaisse.»
- * Note de
Voltaire: On a dit qu'on l'avait vu dans une
église. Est-ce une preuve qu'il devait abjurer? Ne
voit-on pas tous les jours des catholiques venir entendre les
prédicateurs célèbres en Suisse, dans
Amsterdam, à Genève, etc.? Enfin il est
prouvé que Marc-Antoine Calas n'avait pris aucunes
mesures pour changer de religion ainsi nul motif de la
colère prétendue de ses parents.
- On ajoutait
que Lavaisse, âgé de vingt ans, arrivé de
Bordeaux le jour même, avait été choisi,
dans une assemblée de protestants, pour être le
bourreau de la secte, et pour étrangler quiconque
changerait de religion. On criait dans Toulouse que
c'était la jurisprudence ordinaire des
réformés.
- L'extravagance
absurde de ces calomnies me rassurait: plus elles manifestaient
de démence, plus j'espérais de la sagesse de vos
juges.
- Je tremblai,
il est vrai, quand toutes les nouvelles m'apprirent qu'on avait
commencé par faire ensevelir mon frère
Marc-Antoine dans une église catholique, sur cette seule
supposition imaginaire qu'il devait changer de religion. On
nous apprit que la confrérie des pénitents blancs
lui avait fait un service solennel comme à un martyr,
qu'on lui avait dressé un mausolée, et qu'on
avait placé sur ce mausolée sa figure, tenant
dans les mains une palme.
- Je ne
pressentis que trop les effets de cette précipitation et
de ce fatal enthousiasme. Je connus que, puisqu'on regardait
mon frère Marc-Antoine comme un martyr, on ne voyait
dans mon père, dans vous, dans mon frère Pierre,
dans le jeune Lavaisse, que des bourreaux. Je restai dans une
horreur stupide un mois entier. J'avais beau me dire à
moi-même: Je connais mon malheureux frère, je sais
qu'il n'avait point le dessein d'abjurer; je sais que s'il
avait voulu changer de religion, mon père et ma
mère n'auraient jamais gêné sa conscience;
ils ont trouvé bon que mon autre frère Louis se
fit catholique; ils lui font une pension; rien n'est plus
commun, dans les familles de ces provinces, que de voir des
frères de religion différente; l'amitié
fraternelle n'en est point refroidie; la tolérance
heureuse, cette sainte et divine maxime dont nous faisons
profession, ne nous laisse condamner personne; nous ne savons
point prévenir les jugements de Dieu; nous suivons les
mouvements de notre conscience sans inquiéter celle des
autres.
- Il est
incompréhensible, disais-je, que mon père et ma
mère, qui n'ont jamais maltraité aucun de leurs
enfants, en qui je n'ai jamais vu ni colère ni humeur,
qui jamais en leur vie n'ont commis la plus
légère violence, aient passé tout d'un
coup d'une douceur habituelle de trente années à
la fureur inouïe d'étrangler de leurs mains leur
fils a»né, dans la crainte chimérique qu'il
ne quittât une religion qu'il ne voulait point
quitter.
- Voilà,
ma mère, les idées qui me rassuraient; mais
à chaque poste c'étaient de nouvelles alarmes. Je
voulais venir me jeter à vos pieds et baiser vos
cha»nes. Vos amis, mes protecteurs, me retinrent par des
considérations aussi puissantes que ma
douleur.
- Ayant
passé près de deux mois dans cette incertitude
effrayante, sans pouvoir ni recevoir de vos lettres, ni vous
faire parvenir les miennes, je vis enfin les mémoires
produits pour la justification de l'innocence. Je vis dans deux
de ces factums(*) précisément la même chose
que vous dites aujourd'hui dans votre lettre du 15 juin, que
mon malheureux frère Marc-Antoine avait soupé
avec vous avant sa mort, et qu'aucun de ceux qui
assistèrent à ce dernier repas de mon
frère ne se sépara de la compagnie qu'au moment
fatal où l'on s'aperçut de sa fin
tragique.(**)
- (*)
Mémoire pour le sieur J. Calas, négociant de
cette ville, dame Anne-Rose Cabibel, son épouse, et le
sieur J.-P. Calas, un de leurs enfants (par Sudre); et
Observations pour le sieur J. Calas, la dame de Cabibel,
son épouse, et le sieur P.Calas, leur fils (par
Duroux fils).
- (**) Note
de Voltaire: Il est de la plus grande vraisemblance que
Marc-Antoine Calas se défit luimème il
était mécontent de sa situation; il était
sombre, atrabilaire, et lisait souvent des ouvrages sur le
suicide. Lavaisse, avant le souper, l'avait trouvé dans
une profonde rêverie. Sa mère s'en était
aussi aperçue. Ces mots je brûle, répondus
à la servante, qui lui proposait d'approcher du feu,
sont d'un grand poids. Il descend seul en bas après
souper. Il exécute sa résolution funeste. Son
frère, au bout de deux heures, en reconduisant Lavaisse,
est témoin de ce spectacle. Tous deux s'écrient;
le père vient; on dépend le cadavre: voilà
la première cause du jugement porté contre cet
infortuné père. Il ne veut pas d'abord dire aux
voisins, aux chirurgiens: «Mon fils s'est pendu; il faut
qu'on le tra»ne sur la claie, et qu'on déshonore ma
famille.» Il n'avoue la vérité que lorsqu'on
ne peut plus la celer. C'est sa piété paternelle
qui l'a perdu: on a cru qu'il était coupable de la mort
de son fils, parce qu'il n'avait pas voulu d'abord accuser son
fils.
- -Avant
1789, on punissait rigoureusement le suicide. La justice
ordonnait que le mort fut tra»né sur une claie,
pendu par les pieds, et ensuite jeté à la voirie.
(G. A.)
- Pardonnez-moi
si je vous rappelle toutes ces images horribles; il le faut
bien. Nos malheurs nouveaux vous retracent continuellement les
anciens, et vous ne me pardonneriez pas de ne point rouvrir vos
blessures. Vous ne sauriez croire, ma mère, quel effet
favorable fit sur tout le monde cette preuve que mon
père et vous, et mon frère Pierre, et le sieur
Lavaisse, vous ne vous étiez pas quittés un
moment dans le temps qui s'écoula entre ce triste souper
et votre emprisonnement.
- Voici comme
on a raisonné dans tous les endroits de l'Europe
où notre calamité est parvenue; j'en suis bien
informé, et il faut que vous le sachiez. On
disait:
- Si
Marc-Antoine Calas a été étranglé
par quelqu'un de sa famille, il l'a été
certainement par sa famille entière, et par Lavaisse, et
par la servante même: car il est prouvé que cette
famille, et Lavaisse, et la servante (*), furent toujours tous
ensemble; les juges en conviennent; rien n'est plus
avéré. Ou tous les prisonniers sont coupables, ou
aucun d'eux ne l'est; il n'y a pas de milieu. Or il n'est pas
dans la nature qu'une famille jusque-là
irréprochable, un père tendre, la meilleure des
mères, un frère qui aimait son frère, un
ami qui arrivait dans la ville, et qui par hasard avait
soupé avec eux, aient pu prendre tous à la fois,
et en un moment, sans aucune raison, sans le moindre motif, la
résolution inouïe de commettre un parricide. Un tel
complot dans de telles circonstances est impossible (**);
l'exécution en est plus impossible encore. Il est donc
infiniment probable que les juges répareront l'affront
fait à l'innocence.
- * Note de
Voltaire: Cette servante est catholique et pieuse; elle
était dans la maison depuis trente ans; elle avait
beaucoup servi à la conversion d'un des enfants du sieur
Calas. Son témoignage est du plus grand poids. Comment
n'a-t-il pas prévalu sur les présomptions les
plus trompeuses?
- ** Note
de Voltaire: Dans quel temps le père aurait-il pu
pendre son fils? Ce n'est pas avant le souper, puisqu'ils
soupèrent ensemble; ce n'est pas pendant le souper; ce
n'est pas après le souper, puisque le père et la
famille étaient en haut quand le fils était
descendu. Comment le père, assisté même de
main-forte, aurait-il pu pendre son fils aux deux battants
d'une porte au rez-de-chaussée, sans un violent combat,
sans un tumulte horrible? Enfin, pourquoi ce père
aurait-il pendu son fils? Pour le dépendre? Quelle
absurdité dans ces accusations.
- Ces discours
me soutenaient un peu dans mon accablement. Toutes ces
idées de consolation ont été bien vaines.
La nouvelle arriva, au mois de mars, du supplice de mon
père. Une lettre qu'on voulait me cacher, et que
j'arrachai, m'apprit ce que je n'ai pas la force d'exprimer, et
ce qu'il vous a fallu si souvent entendre.
- Soutenez-moi,
ma mère, dans ce moment où je vous écris
en tremblant, et donnez-moi votre courage: il est égal
à votre horrible situation. Vos enfants
dispersés, votre fils a»né mort à vos
yeux, votre mari, mon père, expirant du plus cruel des
supplices, votre dot perdue, l'indigence et l'opprobre
succédant à la considération et à
la fortune voilà donc votre état! mais Dieu vous
reste, il ne vous a pas abandonnée; l'honneur de mon
père vous est cher; vous bravez les horreurs de la
pauvreté, de la maladie, de la honte même, pour
venir de deux cents lieues implorer au pied du trône la
justice du roi, si vous parvenez à vous faire entendre,
vous l'obtiendrez sans doute.
- Que
pourrait-on opposer aux cris et aux larmes d'une mère et
d'une veuve, et aux démonstrations de la raison? Il est
prouvé que mon père ne vous a pas quittée,
qu'il a été constamment avec vous et avec tous
les accusés dans l'appartement d'en haut, tandis que mon
malheureux frère était mort au bas de la maison.
Cela suffit. On a condamné mon père au dernier et
au plus affreux des supplices; mon frère est banni par
un second jugement; et, malgré son bannissement, on le
met dans un couvent de jacobins de la même ville. Vous
êtes hors de cour, Lavaisse hors de cour. Personne n'a
conçu ces jugements extraordinaires et contradictoires.
Pourquoi mon frère n'est-il que banni, s'il est coupable
du meurtre de son frère ? Pourquoi, s'il est banni du
Languedoc, est-il enfermé dans un couvent de Toulouse?
On n'y comprend rien. Chacun cherche la raison de ces
arrêts et de cette conduite, et personne ne la
trouve.
- Tout ce que
je sais, c'est que les juges, sur des indices trompeurs,
voulaient condamner tous les accusés au supplice, et
qu'ils se contentèrent de faire périr mon
père, dans l'idée où ils étaient
que cet infortuné avouerait, en expirant, le crime de
toute la famille. Ils furent étonnés, m'a-t-on
dit, quand mon père, au milieu des tourments, prit Dieu
à témoin de son innocence et de la vôtre,
et mourut en priant ce Dieu de miséricorde de faire
grâce à ces juges de rigueur que la calomnie avait
trompés.
- Ce fut alors
qu'ils prononcèrent l'arrêt qui vous a rendu la
liberté, mais qui ne vous a rendu ni vos biens
dissipés, ni votre honneur indignement flétri, si
pourtant l'honneur dépend de l'injustice des
hommes.
- Ce ne sont
pas les juges que j'accuse: ils n'ont pas voulu sans doute
assassiner juridiquement l'innocence; j'impute tout aux
calomnies, aux indices faux, mal exposés, aux rapports
de l'ignorance (*), aux méprises extravagantes de
quelques déposants, aux cris d'une multitude
insensée, et à ce zèle furieux qui veut
que ceux qui ne pensent pas comme nous soient capables des plus
grands crimes.
- * Note de
Voltaire: Quand le père et la mère en
larmes étaient, vers les dix heures du soir,
auprès de leur fils Marc-Antoine, déjà
mort et froid, ils s'écriaient, ils poussaient des cris
pitoyables, ils éclataient en sanglots; ce sont ces
sanglots, ces cris paternels, qu'on a imaginés
être les cris mêmes de Marc-Antoine Calas, mort
deux heures auparavant et c'est sur cette méprise qu'on
a cru qu'un père et une mère, qui pleuraient leur
fils mort, assassinaient ce fils; et c'est sur cela qu'on a
jugé!
- Il vous sera
aisé sans doute de dissiper les illusions (*) qui ont
surpris des juges, d'ailleurs intègres et
éclairés: car enfin, puisque mon père a
été le seul condamné, il faut que mon
père ait commis seul le parricide. Mais comment se
peut-il faire qu'un vieillard de soixante et huit ans, que j'ai
vu pendant deux ans attaqué d'un rhumatisme sur les
jambes, ait seul pendu un jeune homme de vingt-huit ans, dont
la force prodigieuse et l'adresse singulière
étaient connues?
- *
Note de Voltaire: Un témoin a
prétendu qu'on avait entendu Calas père menacer
son fils quelques semaines auparavant. Quel rapport des menaces
paternelles peuvent-elles avoir avec un parricide? Marc-Antoine
Calas passait sa vie à la paume, au billard, dans les
salles d'armes; le père le menaçait s'il ne
changeait pas. Cette juste correction de l'amour paternel, et
peut-être quelque vivacité, prouveront-elles le
crime le plus atroce et le plus
dénaturé?
- Si le mot de
ridicule pouvait trouver place au milieu de tant d'horreurs, le
ridicule excessif de cette supposition suffirait seul, sans
autre examen, pour nous obtenir la réparation qui nous
est due. Quels misérables indices, quels discours
vagues, quels rapports populaires pourront tenir contre
l'impossibilité physique
démontrée?
- Voilà
où je m'en tiens. Il est impossible que mon père,
que même deux personnes aient pu étrangler mon
frère; il est impossible, encore une fois, que mon
père soit seul coupable, quand tous les accusés
ne l'ont pas quitté d'un moment. Il faut donc
absolument, ou que les juges aient condamné un innocent,
ou qu'ils aient prévariqué, en ne purgeant pas la
terre de quatre monstres coupables du plus horrible
crime.
- Plus je vous
aime et vous respecte, ma mère, moins j'épargne
les termes. L'excès de l'horreur dont on vous a
chargée ne sert qu'à mettre au jour
l'excès de votre malheur et de votre vertu. Vous
demandez à présent ou la mort ou la justification
de mon père; je me joins à vous, et je demande la
mort avec vous si mon père est coupable.
- Obtenez
seulement que les juges produisent le procès criminel:
c'est tout ce que je veux, c'est ce que tout le monde
désire, et ce qu'on ne peut refuser. Toutes les nations,
toutes les religions, y sont intéressées. La
justice est peinte un bandeau sur les yeux, mais doit-elle
être muette? Pourquoi, lorsque l'Europe demande compte
d'un arrêt si étrange, ne s'empresse-t-on pas
à le donner?
- C'est pour
le public que la punition des scélérats est
décernée: les accusations sur lesquelles on les
punit doivent donc être publiques. On ne peut retenir
plus longtemps dans l'obscurité ce qui doit
para»tre au grand jour. Quand on veut donner quelque
idée des tyrans de l'antiquité, on dit qu'ils
décidaient arbitrairement de la vie des hommes. Les
juges de Toulouse ne sont point des tyrans, ils sont les
ministres des lois, ils jugent au nom d'un roi juste; s'ils ont
été trompés, c'est qu'ils sont hommes: ils
peuvent le reconna»tre, et devenir eux-mêmes vos
avocats auprès du trône.
- Adressez-vous
donc à monsieur le chancelier (*), à messieurs
les ministres, avec confiance. Vous êtes timide, vous
craignez de parler; mais votre cause parlera. Ne croyez point
qu'à la cour on soit aussi insensible, aussi dur, aussi
injuste que l'écrivent d'impudents raisonneurs, à
qui les hommes de tous les états sont également
inconnus. Le roi veut la justice: c'est la base de son
gouvernement; son conseil n'a certainement nul
intérêt que cette justice ne soit pas rendue.
Croyez-moi, il y a dans les coeurs de la compassion et de
l'équité: les passions turbulentes et les
préjugés étouffent souvent en nous ces
sentimerts, et le conseil du roi n'a certainement ni passion
dans cette affaire, ni préjugé qui puisse
éteindre ses lumières.
- *
Note de Voltaire: M. le chancelier se souviendra
sans doute de ces paroles de M. d'Aguesseau son
prédécesseur, dans sa dix-septième
mercuriale: Qui croirait qu'une première impression put
décider quelquefois de la vie et de la mort? Un amas
fatal de circonstances, qu'on dirait que la fortune a
assemblées pour faire périr un malheureux, une
foule de témoins muets, et par là plus
redoutables, semblent déposer contre l'innocence; le
juge se prévient, son indignation s'allume, et son
zèle même le séduit. Moins juge
qu'accusateur, il ne voit plus que ce qui sert a condamner, et
il sacrifie aux raisonnements de l'homme celui qu'il aurait
sauvé s'il n'avait admis que les preuves de la loi. Un
événement imprévu fait quelquefois
éclater dans la suite l'innocence accablée sous
le poids des conjectures, et dément ces indices
trompeurs dont la fausse lumière avait ébloui
l'esprit du magistrat. La vérité sort du nuage de
la vraisemhlance; mais elle en sort trop tard le sang de
l'innocent demande vengeance contre la prévention de son
juge, et le magistrat est réduit à pleurer toute
sa vie un malheur que son repentir ne peut plus
réparer.
- - En
1762, le chancelier était Guillaume de Lamoignon,
né en 1693, chancelier en 1750, mort en 1772.
(B.)
- Qu'arrivera-t-il
enfin? Le procès criminel sera-t-il mis sous les yeux du
public ? Alors on verra si le rapport contradictoire d'un
chirurgien, et quelques méprises frivoles, doivent
l'emporter sur les démonstrations les plus
évidentes que l'innocence ait jamais produites(*). Alors
on plaindra les juges de n'avoir point vu par leurs yeux dans
une affaire si importante, et de s'en être
rapportés à l'ignorance; alors les juges
eux-mêmes joindront leurs voix aux nôtres.
Refuseront-ils de tirer la vérité de leur greffe?
Cette vérité s'élèvera alors avec
plus de force.
- *
Note de Voltaire: De très mauvais physiciens ont
prétendu qu'il n'était pas possible que
Marc-Antoine se fut pendu. Rien n'est pourtant si possible: ce
qui ne l'est pas, c'est qu'un vieillard ait pendu, au bas de la
maison, un jeune homme robuste, tandis que ce vieillard
était en haut.
- N.B. Le
père, en arrivant sur le lieu où son fils
était suspendu, avait voulu couper la corde; elle avait
cédé d'elle-même; il crut l'avoir
coupée: il se trompa sur ce fait inutile devant les
juges, qui le crurent coupable.
- On dit
encore que ce père, accablé et hors de
lui-même, avait dit dans son interrogatoire: «Tous
les conviés passèrent, au sortir de table, dans
la même chambre.» Pierre lui répliqua:
«Eh, mon père, oubliez-vous que mon frère
Marc-Antoine sortit avant nous, et descendit en bas? - Oui,
vous avez raison, répondit le père. -Vous vous
coupez, vous êtes coupable», dirent les juges. si
cette anecdote est vraie, de quoi dépend la vie des
hommes?
- Qu'on
oppose indices à indices, dépositions à
dépositions, conjectures à conjectures; et les
avocats qui ont défendu la cause des accusés sont
prêts de faire voir l'innocence de celui qui a
été sacrifié. S'il ne s'agit que de
conviction, on s'en rapporte à l'Europe entière;
s'il s'agit d'un examen juridique, on s'en rapporte à
tous les magistrats, à ceux de Toulouse même, qui,
avec le temps, se feront un honneur et un devoir de
réparer, s'il est possible, un malheur dont plusieurs
d'entre eux sont effrayés aujourd'hui. Qu'ils descendent
dans eux-mêmes, qu'ils voient par quel raisonnement ils
se sont dirigés. Ne se sont-ils pas dit: Marc-Antoine
Calas n'a pu se pendre lui-même: donc d'autres l'ont
pendu; il a soupé avec sa famille et avec Lavaisse: donc
il a été étranglé par sa famille et
par Lavaisse; on l'a vu une ou deux fois, dit-on, dans une
église: donc sa famille protestante l'a
étranglé par principe de religion. Voilà
les présomptions qui les excusent.
- Mais
à présent les juges se disent: Sans doute
Marc-Antoine Calas a pu renoncer à la vie; il est
physiquement impossible que son père seul l'ait
étranglé: donc son père seul ne devait pas
périr; il nous est prouvé que la mère, et
son fils Pierre, et Lavaisse, et la servante, qui seuls
pouvaient être coupables avec le père, sont tous
innocents, puisque nous les avons tous élargis: donc il
nous est prouvé que Calas le père, qui ne les a
point quittés un instant, est innocent comme
eux.
- Il est
reconnu que Marc-Antoine Calas ne devait pas abjurer: donc il
est impossible que son père l'ait immolé à
la fureur du fanatisme. Nous n'avons aucun témoin
oculaire, et il ne peut en être. Il n'y a eu que des
rapports d'après des ouï-dire: or ces vains
rapports ne peuvent balancer la déclaration de Calas sur
la roue, et l'innocence avérée des autres
accusés: donc Calas le père, que nous avons
roué, était innocent; donc nous devons pleurer
sur le jugement que nous avons rendu; et ce n'est pas là
le premier exemple d'un si juste et si noble
repentir.
- Persistez
donc, ma mère, dans votre entreprise; laissons là
notre fortune: nous sommes cinq enfants sans pain, mais nous
avons tous de l'honneur, et nous le préférons
comme vous à la vie. Je me jette à vos pieds, je
les baigne de mes pleurs; je vous demande votre
bénédiction avec un respect que vos malheurs
augmentent.
-
-
-
- A
MONSEIGNEUR LE CHANCELIER
- De
Chatelaine, 7 juillet 1762.
- MONSEIGNEÙR,
- S'il est
permis à un sujet d'implorer son roi, s'il est permis
à un fils, à un frère, de parler pour son
père, pour sa mère et pour son frère, je
me jette à vos pieds avec confiance.
- Toute ma
famille et le fils d'un avocat célèbre,
nommé Lavaisse, ont tous été
accusés d'avoir étranglé et pendu un de
mes frères, pour cause de religion, dans la ville de
Toulouse. Le parlement a fait périr mon père par
le supplice de la roue. C'était un vieillard de
soixante-huit ans, que j'ai vu incommodé des jambes.
Vous sentez, monseigneur, qu'il est impossible qu'il ait pendu
seul un jeune homme de vingt-huit ans, dix fois plus fort que
lui. Il a protesté devant Dieu de son innocence en
expirant. Il est prouvé par le procès-verbal que
mon père n'avait pas quitté un instant le reste
de sa famille, ni le sieur Lavaisse, pendant qu'on suppose
qu'il commettait ce parricide.
- Mon
frère Pierre Calas, accusé comme mon père,
a été banni: ce qui est trop, s'il est innocent,
et trop peu, s'il est coupable. Malgré son bannissement
on le retient dans un couvent, à Toulouse.
- Ma
mère, sans autre appui que son innocence, ayant perdu
tout son bien dans cette cruelle affaire, ne trouve encore
personne qui la présente devant vous. J'ose,
monseigneur, parler en son nom et au mien; on m'assure que les
pièces ci-jointes (*) feront impression sur votre esprit
et sur votre coeur, si vous daignez les lire.
- * Les
Pièces originales; présentées
ici.
- -Le
chancelier était alors Lamoignon, père de
Malesherbes; N.-R. Berryer était garde des sceaux.
(B.)
- Réduit
à l'état le plus déplorable, je ne demande
autre chose, sinon que la vérité
s'éclaire. Tons ceux qui, dans l'Europe entière,
ont entendu parler de cette horrible aventure, joignent leurs
voix à la mienne. Tant que le parlement de Toulouse, qui
m'a ravi mon père et mon bien, ne manifestera pas les
causes d'un tel malheur, on sera en droit de croire qu'il s'est
trompé, et que l'esprit de parti seul a prévalu
par les calomnies auprès des juges les plus
intègres. Je serai surtout en droit de redemander le
sang innocent de mon malheureux père.
- Pour mon
bien, qui est entièrement perdu, ce n'est pas un objet
dont je me plaigne; je ne demande autre chose de votre justice,
et de celle du conseil du roi, sinon que la procédure
qui m'a ravi mon père, ma mère, mon frère,
ma patrie, vous soit au moins communiquée.
- Je suis,
avec le plus profond respect, etc.
- DONAT
CALAS.
-
-
-
- REQUETE
AU ROI EN SON CONSEIL.
- Châtelaine,
7 juillet 1762.
- Donat Calas,
fils de Jean Calas, négociant de Toulouse, et
d'Anne-Rose Cabibel, représente humblement:
- Que, le 13
octobre 1761, son frère a»né Marc-Antoine
Calas se trouva mort dans la maison de son père, vers
les dix heures du soir, après souper;
- Que la
populace, animée par quelques ennemis de la famille,
cria que le mort avait été étranglé
par sa famille même, en haine de la religion
catholique;
- Que le
père, la mère, et un des frères de
l'exposant, le fils d'un avocat nommé Gobert Lavaisse,
âgé de vingt ans, furent mis aux fers;
- Qu'il fut
prouvé que tous les accusés ne s'étaient
pas quittés un seul instant pendant que l'on supposait
qu'ils avaient commis ce meurtre;
- Que Jean
Calas, père du plaignant, a été
condamné à expirer sur la roue, et qu'il a
protesté, en mourant, de son innocence;
- Que tous les
autres accusés ont été
élargis;
- Qu'il est
physiquement impossible que Jean Calas le père,
âgé de soixante-huit ans, ait pu seul pendre
Marc-Antoine Calas, son fils, âgé de vingt-huit
ans, qui était l'homme le plus robuste de la
province;
- Qu'aucun des
indices trompeurs sur lesquels il a été
jugé ne peut balancer cette impossibilité
physique;
- Que Pierre
Calas, frère de l'exposant, accusé de cet
assassinat aussi bien que son père, a été
condamné au bannissement: ce qui est évidemment
trop s'il est innocent, et trop peu s'il est
coupable;
- Qu'on l'a
fait sortir de la ville par une porte, et rentrer par une
autre;
- Qu'on l'a
mis dans un couvent de jacobins;
- Que tous les
biens de la famille ont été
dissipés;
- Que
l'exposant, qui pour lors était absent, est
réduit à la dernière
misère
- Que cette
horrible aventure est, de part ou d'autre, l'effet du plus
horrible fanatisme
- Qu'il
importe à Sa Majesté de s'en faire rendre
compte;
- Que ledit
exposant ne demande autre chose, sinon que Sa Majesté se
fasse représenter la procédure sur laquelle, tous
les accusés étant ou également innocents,
ou également coupables, on a roué le père,
banni et rappelé le fils, ruiné la mère,
mis Lavaisse hors de cour; et comment on a pu rendre des
jugements si contradictoires.
- Donat Calas
se borne à demander que la vérité soit
connue; et, quand elle le sera, il ne demande que
justice.
- FIN
DE LA REQUETE AU ROI.
-
-
-
- MÉMOIRE
DE DONAT CALAS
- POUR
- SON
PÈRE, SA MÈRE, ET SON
FRÈRE.
- NOTE:
Ce Mémoire et la Déclaration qui le
suit, rédigés aussi par Voltaire, parurent en
1762, peut-être en même temps que les
Pièces originales
- .Je commence
par avouer que toute notre famille est née dans le sein
d'une religion qui n'est pas la dominante. On sait assez
combien il en coûté à la probité de
changer. Mon père et ma mère ont
persévéré dans la religion de leurs
pères. On nous a trompés peut-être, mes
parents et moi, quand on nous a dit que cette religion est
celle que professaient autrefois la France, la Germanie et
l'Angleterre, lorsque le concile de Francfort, assemblé
par Charlemagne, condamnait le culte des images; lorsque
Ratram, sous Charles le Chauve, écrivait en cent
endroits de son livre, en faisant parler Jésus-Christ
même: «Ne croyez pas que ce soit corporellement que
vous mangiez ma chair et buviez mon sang»; lorsqu'on
chantait dans la plupart des églises cette
homélie conservée dans plusieurs
bibliothèques: «Nous recevons le corps et le sang
de Jésus-Christ, non corporellement, mais
spirituellement.»
- Quand on se
fut fait, m'a-t-on dit, des notions plus relevées de ce
mystère; quand on crut devoir changer l'économie
de l'Église, plusieurs évêques ne
changèrent point: surtout Claude, évêque de
Turin, retint les dogmes et le culte que le concile de
Francfort avait adoptés, et qu'il crut être ceux
de l'Église primitive; il eut toujours un troupeau
attaché à ce culte. Le grand nombre
prévalut, et prodigua à nos pères les noms
de manichéens, de bulgares, de patarins, de lombards; de
vaudois, d'albigeois, de huguenots, de calvinistes.
- Telles sont
les idées acquises par l'examen que ma jeunesse a pu me
permettre: je ne les rapporte pas pour étaler une vaine
érudition, mais pour tâcher d'adoucir dans
l'esprit de nos frères catholiques la haine qui peut les
armer contre leurs frères; mes notions peuvent
être erronées, mais ma bonne foi n'est point
criminelle.
- Nous avons
fait de grandes fautes, comme tous les autres hommes: nous
avons imité les fureurs des Guises; mais nous avons
combattu pour Henri IV, si cher à Louis XV. Les horreurs
des Cévennes, commises par des paysans insensés,
et que la licence des dragons avait fait na»tre, ont
été mises en oubli, comme les horreurs de la
Fronde. Nous sommes les enfants de Louis XV, ainsi que ses
autres sujets; nous le vénérons; nous
chérissons en lui notre père commun; nous
obéissons à toutes ses lois; nous payons avec
allégresse des impôts nécessaires pour le
soutien de sa juste guerre (*); nous respectons le
clergé de France, qui fait gloire d'être soumis
comme nous à son autorité royale et paternelle;
nous révérons les parlements; nous les regardons
comme les défenseurs du trône et de l'État
contre les entreprises ultramontaines. C'est dans ces
sentiments que j'ai été élevé, et
c'est ainsi que pense parmi nous quiconque sait lire et
écrire. Si nous avons quelques grâces à
demander, nous les espérons en silence de la
bonté du meilleur des rois.
- * La
guerre de Sept ans, qui dura de 1756 à
1763
- Il
n'appartient pas à un jeune homme, à un
infortuné, de décider laquelle des deux religions
est la plus agréable à l'Être
suprême; tout ce que je sais, c'est que le fond de la
religion est entièrement semblable pour tous les coeurs
bien nés; que tous aiment également Dieu, leur
patrie et leur roi.
- L'horrible
aventure dont je vais rendre compte pourra émouvoir la
justice de ce roi bienfaisant et de son conseil, la
charité du clergé, qui nous plaint en nous
croyant dans l'erreur, et la compassion généreuse
du parlement même qui nous a plongés dans la plus
affreuse calamité où une famille honnête
puisse être réduite.
- Nous sommes
actuellement cinq enfants orphelins: car notre père a
péri par le plus grand des supplices, et notre
mère poursuit loin de nous, sans secours et sans appui,
la justice due à la mémoire de mon père.
Notre cause est celle de toutes les familles; c'est celle de la
nature: elle intéresse l'État, la religion, et
les nations voisines.
- Mon
père, Jean Calas, était un négociant
établi à Toulouse depuis quarante ans. Ma
mère est Anglaise; mais elle est, par son aïeule,
de la maison de La Garde-Montesquieu, et tient à la
principale noblesse du Languedoc. Tous deux ont
élevé leurs enfants avec tendresse; jamais aucun
de nous n'a essuyé d'eux ni coups ni mauvaise humeur; il
n'a peut-être jamais été de meilleurs
parents.
- S'il fallait
ajouter à mon témoignage des témoignages
étrangers, j'en produirais plusieurs.(*)
- *
Note de Voltaire: J'atteste devant Dieu que j'ai
demeuré pendant quatre ans à Toulouse, chez les
sieur et dame Calas; que je n'ai jamais vu une famille plus
unie, ni un père plus tendre, et que, dans l'espace de
quatre années, il ne s'est pas mis une fois en
colère; que si j'ai quelques sentiments d'honneur, de
droiture, et de modération, je les dois à
l'éducation que j'ai reçue chez
lui.
- Genève,
5 juillet 1762.
- Signé
J. CALVET, caissier des postes de Suisse, d'Allemagne, et
d'Italie.
- Tous ceux
qui ont vécu avec nous savent que mon père ne
nous a jamais gênés sur le choix d'une religion:
il s'en est toujours rapporté à Dieu et à
notre conscience. Il était si éloigné de
ce zèle amer qui indispose les esprits qu'il a toujours
eu dans sa maison une servante catholique.
- Cette
servante très pieuse contribua à la conversion
d'un de mes frères, nommé Louis: elle resta
auprès de nous après cette action; on ne lui fit
aucuns reproches. Il n'y a point de plus forte preuve de la
bonté du coeur de mes parents.
- Mon
père déclara en présence de son fils
Louis, devant M. de Lamotte, conseiller au parlement,
«que, pourvu que la conversion de son fils fût
sincère, il ne pouvait la désaprouver, parce que
de gêner les consciences ne sert qu'à faire des
hypocrites». Ce furent ses propres paroles, que mon
frère Louis a consignées dans une
déclaration publique, au temps de notre
catastrophe.
- Mon
père lui fit une pension de quatre cents livres, et
jamais aucun de nous ne lui a fait le moindre reproche de son
changement. Tel était l'esprit de douceur et d'union que
mon père et ma mère avaient établi dans
notre famille. Dieu la bénissait; nous jouissions d'un
bien honnête; nous avions des amis; et pendant quarante
ans notre famille n'eut dans Toulouse ni procès ni
querelle avec personne. Peut-être quelques marchands,
jaloux de la prospérité d'une maison de commerce
qui était d'une autre religion qu'eux, excitaient la
populace contre nous; mais notre modération constante
semblait devoir adoucir leur haine.
- Voici
comment nous sommes tombés de cet état heureux
dans le plus épouvantable désastre. Notre
frère a»né Marc-Antoine Calas, la source de
tous nos malheurs, était d'une humeur sombre et
mélancolique; il avait quelques talents, mais n'ayant pu
réussir ni à se faire recevoir licencié en
droit, parce qu'il eût fallu faire des actes de
catholique, ou acheter des certificats; ne pouvant être
négociant, parce qu'il n'y était pas propre; se
voyant repoussé dans tous les chemins de la fortune, il
se livrait à une douleur profonde. Je le voyais souvent
lire des morceaux de divers auteurs sur le suicide,
tantôt de Plutarque ou de Sénèque,
tantôt de Montaigne: il savait par coeur la traduction en
vers du fameux monologue de Hamlet, si célèbre en
Angleterre, et des passages d'une tragicomédie
française intitulée Sidney. Je ne croyais pas
qu'il dût mettre un jour en pratique des leçons si
funestes.
- Enfin un
jour, c'était le 13 octobre 1761 (je n'y étais
pas; mais on peut bien croire que je ne suis que trop
instruit); ce jour, dis-je, un fils de M. Lavaisse, fameux
avocat de Toulouse, arrivé de Bordeaux, veut aller voir
son père qui était à la campagne; il
cherche partout des chevaux, il n'en trouve point: le hasard
fait que mon père et mon frère Marc-Antoine, son
ami, le rencontrent et le prient à souper; on se met
à table à sept heures, selon l'usage simple de
nos familles réglées et occupées, qui
finissent leur journée de bonne heure pour se lever
avant le soleil. Le père, la mère, les enfants,
leur ami, font un repas frugal au premier étage. La
cuisine était auprès de la salle à manger;
la même servante catholique apportait les plats,
entendait et voyait tout. Je ne peux que répéter
ici ce qu'a dit ma malheureuse et respectable mère. Mon
frère Marc-Antoine se lève de table un peu avant
les autres; il passe dans la cuisine; la servante lui dit:
«Approchez-vous du feu. - Ah! répondit-il, je
brûle.» Après avoir proféré ces
paroles, qui n'en disent que trop, il descend en bas, vers le
magasin, d'un air sombre, et profondément pensif. Ma
famille, avec le jeune Lavaisse, continue une conversation
paisible jusqu'à neuf heures trois quarts, sans se
quitter un moment.
- M.Lavaisse
se retire; ma mère dit à son second fils Pierre
de prendre un flambeau et de l'éclairer. Ils descendent;
mais que1 spectacle s'offre à eux! Ils voient la porte
du magasin ouverte, les deux battants rapprochés, un
bâton, fait pour serrer et assujettir les ballots,
passé au haut des deux battants, une corde à
noeuds coulants, et mon malheureux frère suspendu en
chemise, les cheveux arrangés, son habit plié sur
le comptoir.
- A cet objet
ils poussent des cris «Ah, mon Dieu! ah, mon Dieu!»
Ils remontent l'escalier; ils appellent le père; la
mère suit toute tremblante: ils l'arrêtent; ils la
conjurent de rester. Ils volent chez les chirurgiens, chez les
magistrats. La mère, effrayée, descend avec la
servante; les pleurs et les cris redoublent: que faire?
laissera-t-on le corps de son fils sans secours? le père
embrasse son fils mort; la corde cède au premier effort,
parce qu'un des bouts du bâton glissait aisément
sur les battants, et que le corps soulevé par le
père n'assujettissait plus ce billot. La mère
veut faire avaler à son fils des liqueurs spiritueuses;
la servante multiplie en vain ses secours; mon frère
était mort. Aux cris et aux sanglots de mes parents, la
populace environnait déjà la maison: j'ignore
quel fanatique imagina le premier que mon frère
était un martyr; que sa famille l'avait
étranglé pour prévenir son abjuration. Un
autre ajoute que cette abjuration devait se faire le lendemain.
Un troisième dit que la religion protestante ordonne aux
pères et mères d'égorger ou
d'étrangler leurs enfants, quand ils veulent se faire
catholiques. Un quatrième dit que rien n'est plus vrai;
que les protestants ont, dans leur dernière
assemblée, nommé un bourreau de la secte; que le
jeune Lavaisse âgé de dix-neuf à vingt ans,
est le bourreau; que ce jeune homme, la candeur et la douceur
même, est venu de Bordeaux à Toulouse
exprès pour pendre son ami. Voilà bien le peuple!
voilà un tableau trop fidèle de ses
excès!
- Ces rumeurs
volaient de bouche en bouche: ceux qui avaient entendu les cris
de mon frère Pierre et du sieur Lavaisse, et les
gémissements de mon père et de ma mère,
à neuf heures trois quarts, ne manquaient pas d'affirmer
qu'ils avaient entendu les cris de mon frère
étranglé, et qui était mort deux heures
auparavant.
- Pour comble
de malheur, le capitoul, prévenu par ces clameurs,
arrive sur le lieu avec ses assesseurs, et fait transporter le
cadavre à l'hôtel de ville. Le
procès-verbal se fait à cet hôtel, au lieu
d'être dressé dans l'endroit même où
l'on a trouvé le mort, comme on m'a dit que la loi
l'ordonne. Quelques témoins ont dit que ce
procès-verbal, fait à l'hôtel de ville,
était daté de la maison du mort; ce serait une
grande preuve de l'animosité qui a perdu ma famille.
Mais qu'importe que le juge en premier ressort ait commis cette
faute? nous ne prétendons accuser personne; ce n'est pas
cette irrégularité seule qui nous a
été fatale.
- Ces premiers
juges ne balançaient pas entre un suicide, qui est rare
en ce pays, et un parricide, qui est encore mille fois plus
rare. Ils croyaient le parricide; ils le supposaient sur le
changement prétendu de religion que le mort devait
faire; et on va visiter ses papiers, ses livres, pour voir s'il
n'y avait pas quelque preuve de ce changement; on n'en trouve
aucune.
- Enfin un
chirurgien, nommé Lamarque, est nommé pour ouvrir
l'estomac de mon frère, et pour faire rapport s'il y a
trouvé des restes d'aliments. Son rapport dit que les
aliments ont été pris quatre heures avant sa
mort. Il se trompait évidemment de plus de deux. Il est
clair qu'il voulait se faire valoir en prononçant quel
temps il faut pour la digestion, que la diversité des
tempéraments rend plus ou moins lente. Cette petite
erreur d'un chirurgien devait-elle préparer le supplice
de mon père? La vie des hommes dépend donc d'un
mauvais raisonnement!
- Il n'y avait
point de preuve contre mes parents, et il ne pouvait y en avoir
aucune: on eut incontinent recours à un monitoire. Je
n'examine pas si ce monitoire était dans les
règles; on y supposait le crime, et on demandait la
révélation des preuves. On supposait Lavaisse
mandé de Bordeaux pour être bourreau, et on
supposait l'assemblée tenue pour élire ce
bourreau le jour même de l'arrivée de Lavaisse, 13
octobre. On imaginait que quand on étrangle quelqu'un
pour cause de religion on le fait mettre à genoux; et on
demandait si l'on n'avait pas vu le malheureux Marc-Antoine
Calas à genoux devant son père, qui
l'étranglait, pendant la nuit, dans un endroit où
il n'y avait point de lumière.
- On
était sûr que mon frère était mort
catholique, et l'on demandait des preuves de sa
catholicité, quoiqu'il soit bien prouvé que mon
frère n'avait point changé de religion, et n'en
voulait point changer. On était surtout persuadé
que la maxime de tous les protestants est d'étrangler
leur fils, dès qu'ils ont le moindre soupçon que
leur fils veut être catholique; et ce fanatisme fut
porté au point que toute l'Église de
Genève se crut obligée d'envoyer une attestation
de son horreur pour des idées si abominables et si
insensées, et de l'étonnement où elle
était qu'un tel soupçon eût jamais pu
entrer dans la tête des juges.
- Avant que ce
monitoire parût, il s'éleva une voix du peuple qui
dit que mon frère Marc-Antoine devait entrer le
lendemain dans la confrérie des pénitents blancs:
aussitôt les capitouls ordonnèrent qu'on
enterrât mon frère pompeusement au milieu de
l'église de Saint-Étienne. Quarante prêtres
et tous les pénitents blancs assistèrent au
convoi (*).
- * Note de
Voltaire: Il y a dans Toulouse quatre confréries
de pénitents, blancs, bleus, gris, noirs: ils portent
une longue capote, avec un masque de la même couleur,
percé de deux trous pour les yeux.
- Quatre jours
après, les pénitents blancs lui firent un service
solennel dans leur chapelle; l'église était
tendue de blanc; on avait élevé au milieu un
catafalque, au haut duquel on voyait un squelette humain qu'un
chirurgien avait prêté: ce squelette tenait dans
une main un papier où on lisait ces mots: Abjiuration
contre l'hérésie; et de l'autre, une palme,
l'emblème de son martyre.
- Le
lendemain, les cordeliers lui firent un pareil service. On peut
juger si un tel éclat acheva d'enflammer tous les
esprits les pénitents blancs et les cordeliers
dictaient, sans le savoir, la mort de mon
père.
- Le parlement
saisit bientôt cette affaire. Il cassa d'abord la
procédure des capitouls, qui, étant vicieuse dans
toutes ses formes, ne pouvait pas subsister; mais le
préjugé subsista avec violence. Tous les
zélés voulaient déposer; l'un avait vu
dans l'obscurité, à travers le trou de la serrure
de la porte, des hommes qui couraient; l'autre avait entendu,
du fond d'une maison éloignée à l'autre
bout de la rue, la voix de Calas, qui se plaignait d'avoir
été étranglé.
- Un peintre,
nommé Matei, dit que sa femme lui avait dit qu'une
nommée Mandrille lui avait dit qu'une inconnue lui avait
dit avoir entendu les cris de Marc-Antoine Calas à une
autre extrémité de la ville.
- Mais pour
tous les accusés, mon père, ma mère, mon
frère Pierre, le jeune Lavaisse, et la servante, ils
furent unanimement d'accord sur tous les points essentiels:
tous aux fers, tous séparément interrogés,
ils soutinrent la vérité, sans jamais varier ni
au récolement, ni à la confrontation.
- Leur trouble
mortel put, à la vérité, faire chanceler
leur mémoire sur quelques petites circonstances qu'ils
n'avaient aperçues qu'avec des yeux égarés
et offusqués par les larmes; mais aucun d'eux
n'hésita un moment sur tout ce qui pouvait constater
leur innocence. Les cris de la multitude, l'ignorante
déposition du chirurgien Lamarque, des témoins
aunculaires qui, ayant une fois débité des
accusations absurdes, ne voulaient pas s'en dédire,
l'emportèrent sur la vérité la plus
évidente.
- Les juges
avaient, d'un côté, ces accusations frivoles sous
leurs yeux; de l'autre, l'impossibilité
démontrée que mon père, âgé
de soixante-huit ans, eût pu seul pendre un jeune homme
de vingt-huit ans beaucoup plus robuste que lui, comme on l'a
déjà dit ailleurs; ils convenaient bien que ce
crime était difficile à commettre, mais ils
prétendaient qu'il était encore plus. difficile
que mon frère Marc-Antoine Calas eut terminé
lui-même sa vie.
- Vainement
Lavaisse et la servante prouvaient l'innocence de mon
père, de ma mère, et de mon frère Pierre;
Lavaisse et la servante étaient eux-mêmes
accusés; le secours de ces témoins
nécessaires nous fut ravi contre l'esprit de toutes les
lois.
- Il est
clair, et tout le monde en convient, que si Marc-Antoine Calas
avait été assassiné, il l'avait
été par toute la famille, et par Lavaisse et par
la servante, qu'ils étaient ou tous innocents ou tous
coupables, puisqu'il était prouvé qu'ils ne
s'étaient pas quittés un moment, ni pendant le
souper, ni après le souper.
- J'ignore par
quelle fatalité les juges crurent mon père
criminel, et comment la forme l'emporta sur le fond. On m'a
assuré que plusieurs d'entre eux soutinrent longtemps
l'innocence de mon père, mais qu'ils
cédèrent enfin à la pluralité.
Cette pluralité croyait toute ma famille et le jeune
Lavaisse également coupables. Il est certain qu'ils
condamnèrent mon malheureux père au supplice de
la roue, dans l'idée où ils étaient qu'il
ne résisterait pas aux tourments, et qu'il avouerait les
prétendus compagnons de son crime dans l'horreur du
supplice.
- Je l'ai
déjà dit, et je ne peux trop le
répéter, ils furent surpris de le voir mourir en
prenant à témoin de son innocence le Dieu devant
lequel il allait compara»tre. Si la voix publique ne m'a
pas trompé, les deux dominicains, nommés Bourges
et Caldagués, qu'on lui donna pour l'assister dans ces
moments cruels, ont rendu témoignage de sa
résignation; ils le virent pardonner à ses juges,
et les plaindre; ils souhaitèrent enfin de mourir un
jour avec des sentiments de piété aussi
touchants.
- Les juges
furent obligés bientôt après
d'élargir ma mère, le jeune Lavaisse et la
servante; ils bannirent mon frère Pierre; et j'ai
toujours dit avec le public: Pourquoi le bannir s'il est
innocent, et pourquoi se borner au bannissement s'il est
coupable?
- J'ai
toujours demandé pourquoi, ayant été
conduit hors de la ville par une porte, on le laissa ou on le
fit rentrer sur-le-champ par une autre; pourquoi il fut
enfermé trois mois dans un couvent de dominicains.
Voulait-on le convertir au lieu de le bannir? Mettait-on son
rappel au prix de son changement? Punissait-on, faisait-on
grâce arbitrairement ? Et le supplice affreux de son
père était-il un moyen de persuasion?
- Ma
mère, après cette horrible catastrophe, a eu le
courage d'abandonner sa dot et son bien; elle est allée
à Paris, sans autre secours que sa vertu, implorer la
justice du roi: elle ose espérer que le conseil de Sa
Majesté se fera représenter la procédure
faite à Toulouse. Qui sait même si les juges,
touchés de la conduite généreuse de ma
mère, n'en verront pas plus évidemment
l'innocence, déjà entrevue, de celui qu'ils ont
condamné? N'apercevront-ils pas qu'une femme sans appui
n'oserait assurément demander la révision du
procès si son mari était criminel? Aurait-elle
fait deux cents lieues pour aller chercher la mort qu'elle
mériterait? cela n'est pas plus dans la nature humaine
que le crime dont mon père a été
accusé. Car, je le dis encore avec horreur, si mon
père a été coupable de ce parricide, ma
mère et mon frère Pierre Calas le sont aussi;
Lavaisse et la servante ont en, sans doute, part au crime. Ma
mère aurait-elle entrepris ce voyage pour les exposer
tous au supplice, et s'y exposer elle-même?
- Je
déclare que je pense comme elle, que je me soumets
à la mort comme elle, si mon père a commis,
contre Dieu, la nature, l'État, et la religion, le crime
qu'on lui a imputé.
- Je me joins
donc à cette vertueuse mère par cet acte
légal ou non, mais public et signé de moi. Les
avocats qui prendront sa défense pourront mettre au jour
les nullités de la procédure c'est à eux
qu'il appartient de montrer que Lavaisse et la servante,
quoique accusés, étaient des témoins
nécessaires, qui déposaient invinciblement en
faveur de mon père. Ils exposeront la
nécessité où les juges ont
été réduits de supposer qu'un vieillard de
soixante et huit ans, que j'ai vu incommodé des jambes,
avait seul pendu son propre fils, le plus robuste des hommes,
et l'impossibilité absolue d'une telle
exécution.
- Ils mettront
dans la balance, d'un côté cette
impossibilité physique, et de l'autre des rumeurs
populaires. Ils pèseront les probabilités; ils
discuteront les témoignages auriculaires.
- Que ne
diront-ils pas sur tous les soins que nous avons pris depuis
trois mois pour nous faire communiquer la procédure, et
sur les refus qu'on nous en a faits! Le public et le conseil ne
seront-ils pas saisis d'indignation et de pitié quand
ils apprendront qu'un procureur nous a demandé deux
cents louis d'or, à nous, à une famille devenue
indigente, pour nous faire avoir cette procédure d'une
manière illégale?
- Je ne
demande point pardon aux juges d'élever ma voix contre
leur arrêt; ils le pardonnent sans doute à la
piété filiale; ils me mépriseraient trop
si j'avais une autre conduite, et peut-être quelque-uns
d'eux mouilleront mon mémoire de leurs
larmes.
- Cette
aventure épouvantable intéresse toutes les
religions et toutes les nations; il importe à
l'État de savoir de quel côté est le
fanatisme le plus dangereux. Je frémis en y pensant, et
plus d'un lecteur sensible frémira comme
moi-même.
- Seul dans un
désert, dénué de conseil, d'appui, de
consolation, je dis à monseigneur le chancelier et
à tout le conseil d'État:
- Cette
requête que je mets à vos pieds est
extrajudiciaire; mais rendez-la judiciaire par votre
autorité et par votre justice. N'ayez point pitié
de ma famille, mais faites para»tre la
vérité. Que le parlement de Toulouse ait le
courage de publier les procédures l'Europe les demande,
et, s'il ne les produit pas, il voit ce que l'Europe
décide.
- A
Châtelaine, 22 juillet 1762.
- Signé:DONAT
CALAS.
-
-
-
-
- DÉCLARATION
DE PIERRE CALAS.
- En arrivant
chez mon frère Donat Calas pour pleurer avec lui, j'ai
trouvé entre ses mains ce mémoire qu'il venait
d'achever pour la justification de notre malheureuse famille.
Je me joins à ma mère et à lui; je suis
prêt d'attester la vérité de tout ce qu'il
vient d'écrire; je ratifie tout ce qu'a dit ma
mère, et, devenu plus courageux par son exemple, je
demande avec elle à mourir si mon père a
été criminel.
- Je
dépose et je promets de déposer juridiquement ce
qui suit:
- Le jeune
Gobert Lavaisse, âgé de dix-neuf à vingt
ans, jeune homnie des moeurs les plus douces,
élevé dans la vertu par son père,
célèbre avocat, était l'ami de
Marc-Antoine, mon frère; et ce frère était
un homme de lettres, qui avait étudié aussi pour
être avocat. Lavaisse soupa avec nous, le 13 octobre
1761, comme on l'a dit. Je m'étais un peu endormi
après le souper, au temps que le sieur Lavaisse voulut
prendre congé. Ma mère me réveilla, et me
dit d'éclairer notre ami avec un flambeau.
- On peut
juger de mon horrible surprise quand je vis mon frère
suspendu, en chemise, aux deux battants de la porte de la
boutique qui donne dans le magasin. Je poussai des cris
affreux; j'appelai mon père; il descend éperdu;
il prend à bras-le-corps son malheureux fils, en faisant
glisser le bâton et la corde qui le soutenaient; il
ôte la corde du cou, en élargissant le noeud; il
tremblait, il pleurait, il s'écriait dans cette
opération funeste: «Va, me dit-il, au nom de Dieu,
chez le chirurgien Camoire, notre voisin; peut-être mon
pauvre fils n'est pas tout à fait
mort.»
- Je vole chez
le chirurgien; je ne trouve que le sieur Gorse, son
garçon, et je l'amène avec moi. Mon père
était entre ma mère et un de nos voisins,
nommé Delpech, fils d'un négociant catholique,
qui pleurait avec eux. Ma mère tâchait en vain de
faire avaler à mon frère des eaux spiritueuses,
et lui frottait les tempes. Le chirurgien Gorse lui tâte
le pouls et le coeur; il le trouve mort et déjà
froid; il lui ôte son tour de cou qui était de
taffetas noir; il voit l'impression d'une corde, et prononce
qu'il est étranglé.
- Sa chemise
n'était pas seulement froissée, ses cheveux
arrangés comme à l'ordinaire, et je vis son habit
proprement plié sur le comptoir. Je sors pour aller
partout demander conseil. Mon père, dans l'excès
de sa douleur, me dit: «Ne va pas répandre le bruit
que ton frère s'est défait lui-même; sauve
au moins l'honneur de ta misérable famille.» Je
cours, tout hors de moi, chez le sieur Caseing, ami de la
maison, négociant qui demeurait à la Bourse; je
l'amène au logis: il nous conseille d'avertir au plus
vite la justice. Je vole chez le sieur Clausade, homme de loi;
Lavaisse court chez le greffier des capitouls, chez l'assesseur
ma»tre Monier. Je retourne en hâte me rendre
auprès de mon père, tandis que Lavaisse et
Clausade faisaient relever l'assesseur, qui était
déjà couché, et qu'ils vont avertir le
capitoul lui-même.
- Le capitoul
était déjà parti, sur la rumeur publique,
pour se rendre chez nous. Il entre avec quarante soldats;
j'étais en bas pour le recevoir; il ordonne qu'on me
garde.
- Dans ce
moment même, l'assesseur arrivait avec les sieurs
Clausade et Lavaisse. Les gardes ne voulurent point laisser
entrer Lavaisse, et le repoussèrent: ce ne fut qu'en
faisant beaucoup de bruit, en insistant, et en disant qu'il
avait soupé avec la famille, qu'il obtint du capitoul
qu'on le laissât entrer.
- Quiconque
aura la moindre connaissance du coeur humain verra bien par
toutes ces démarches quelle était notre
innocence: comment pouvait-on la soupçonner? A-t-on
quelque exemple, dans les annales du monde et des crimes, d'un
pareil parricide, commis sans aucun dessein, sans aucun
intérêt, sans aucune cause?
- Le capitoul
avait mandé le sieur Latour, médecin, et les
sieurs Lamarque et Perronet, chirurgiens; ils visitèrent
le cadavre en ma présence, cherchèrent des
meurtrissures sur le corps, et n'en trouvèrent point.
Ils ne visitèrent point la corde ils firent un rapport
secret, seulement de bouche, au capitoul; après quoi on
nous mena tous à l'hôtel de ville,
c'est-à-dire mon père, ma mère, le sieur
Lavaisse; le sieur Caseing notre ami, la servante, et moi. On
prit le cadavre et les habits, qui furent portés aussi
à l'hôtel de ville.
- Je voulus
laisser un flambeau allumé dans le passage, au bas de la
maison, pour retrouver de la lumière à notre
retour. Telle était ma sécurité et celle
de mon père que nous pensions être menés
seulement à l'hôtel de ville pour rendre
témoignage à la vérité, et que nous
nous flattions de revenir coucher chez nous; mais le capitoul,
souriant de ma simplicité, fit éteindre le
flambeau, en disant que nous ne reviendrions pas sitôt.
Mon père et moi nous fûmes mis dans un cachot
noir; ma mère, dans un cachot éclairé,
ainsi que Lavaisse, Caseing, et la servante. Le
procès-verbal du capitoul, et celui des médecins
et chirurgiens, furent faits le lendemain à
l'hôtel.
- Caseing, qui
n'avait point soupé avec nous, fut bientôt
élargi; nous fûmes, tous les autres,
condamnés à la question, et mis aux fers, le 18
novembre. Nous en appelâmes au parlement, qui cassa la
sentence du capitoul, irrégulière en plusieurs
points, et qui continua les procédures.
- On
m'interrogea plus de cinquante fois: on me demanda si mon
frère Marc-Antoine devait se faire catholique. Je
répondis que j'étais sûr du contraire; mais
qu'étant homme de lettres et amateur de la musique, il
allait quelquefois entendre les prédicateurs qu'il
croyait éloquents, et la musique quand elle était
bonne: et que m'eût importé, bon Dieu! que mon
frère Marc-Antoine eût été
catholique ou réformé? En ai-je moins vécu
en intelligence avec mon frère Louis, parce qu'il allait
à la messe? N'ai-je pas d»né avec lui?
N'ai-je pas toujours fréquenté les catholiques
dans Toulouse? Aucun s'est-il jamais plaint de mon père
et de moi? N'ai-je pas appris dans le célèbre
mandement de M. l'évêque de Soissons qu'il faut
traiter les Turcs mêmes comme nos frères: pourquoi
aurais-je traité mon frère comme une bête
féroce? Quelle idée! quelle
démence!
- Je fus
confronté souvent avec mon père, qui en me voyant
éclatait en sanglots, et fondait en larmes.
L'excès de ses malheurs dérangeait quelquefois sa
mémoire. «Aide-moi», me disait-il; et je le
remettais sur la voie concernant des points tout à fait
indifférents: par exemple, il lui échappa de dire
que nous sort»mes de table tous ensemble. «Eh! mon
père, m'écriai-je, oubliez-vous que mon
frère sortit quelque temps avant nous? - Tu as raison,
me dit-il; pardonne, je suis troublé.»
- Je fus
confronté avec plus de cinquante témoins. Les
coeurs se soulèveront de pitié quand ils verront
quels étaient ces témoins et ces
témoignages. C'était un nommé Popis,
garçon passementier, qui, entendant d'une maison voisine
les cris que je poussais à la vue de mon frère
mort, s'était imaginé entendre les cris de mon
frère même; c'était une bonne servante qui,
lorsque je m'écriais: Ah, mon Dieu! crut que je criais
au voleur; c'étaient des ouï-dire d'après
des ouï-dire extravagants. Il ne s'agissait guère
que de méprises pareilles.
- La
demoiselle Peyronet déposa qu'elle m'avait vu dans la
rue, le 13 octobre, à dix heures du soir, «courant
avec un mouchoir, essuyant mes larmes, disant que mon
frère était mort d'un coup
d'épée». Non, je ne le dis pas, et si je
l'avais dit, j'aurais bien fait de sauver l'honneur de mon cher
frère. Les juges auraient-ils fait plus d'attention
à la partie fausse de cette déposition
qu'à la partie pleine de vérité qui
parlait de mon trouble et de mes pleurs? Et ces pleurs ne
s'expliquaient-ils pas d'une manière invincible contre
toutes les accusations frivoles sous lesquelles l'innocence la
plus pure a succombé? Il se peut qu'un jour mon
père, mécontent de mon frère
a»né, qui perdait son temps et son argent au
billard, lui ait dit: «Si tu ne changes, je te punirai, ou
je te chasserai, ou tu te perdras, tu périras»;
mais fallait-il qu'un témoin, fanatique
impétueux, donnât une interprétation
dénaturée à ces paroles paternelles, et
qu'il substituât méchamment aux mots: si tu ne
changes de conduite, ces mots cruels: si tu changes de
religion? Fallait-il que les juges, entre un témoin
inique et un père accusé, décidassent en
faveur de la calomnie contre la nature?
- Il n'y eut
contre nous aucun témoin valable; et on s'en apercevra
bien à la lecture du procès-verbal, si on peut
parvenir à tirer ce procès du greffier, qui a eu
défense d'en donner communication.
- Tout le
reste est exactement conforme à ce que ma mère et
mon frère Donat Calas ont écrit. Jamais innocence
ne fut plus avérée. Des deux jacobins qui
assistèrent au supplice de mon père, l'un, qui
était venu de Castres, dit publiquement: Il est mort en
juste. Sur quoi donc, me dira-t-on, votre père a-t-il
été condamné? Je vais le dire, et on va
être étonné.
- Le capitoul,
l'assesseur M. Monier, le procureur du roi, l'avocat du roi,
étaient venus, quelques jours après notre
détention, avec un expert, dans la maison où mon
frère Marc-Antoine était mort: quel était
cet expert? pourra-t-on le croire? c'était le bourreau.
On lui demanda si un homme pouvait se pendre aux deux battants
de la porte du magasin où j'avais trouvé mon
frère. Ce misérable, qui ne connaissait que ses
opérations, répondit que la chose n'était
pas praticable. C'était donc une affaire de physique?
Hélas! l'homme le moins instruit aurait vu que la chose
n'était que trop aisée; et Lavaisse, qu'on peut
interroger avec moi, en avait vu de ses yeux la preuve bien
évidente.
- Le
chirurgien Lamarque, appelé pour visiter le cadavre,
pouvait être indisposé contre moi parce qu'un
jour, dans un de ses rapports juridiques, ayant pris l'oeil
droit pour l'oeil gauche, j'avais relevé sa
méprise. Ainsi mon père fut sacrifié
à l'ignorance autant qu'aux préjugés. Il
s'en fallut bien que les juges fussent unanimes; mais la
pluralité l'emporta.
- Après
cette horrible exécution les juges me firent
compara»tre; l'un d'eux me dit ces mots: «Nous avons
condamné votre père; si vous n'avouez pas, prenez
garde à vous.» Grand Dieu que pouvais-je avouer,
sinon que des hommes trompés avaient répandu le
sang innocent?
- Quelques
jours après, le P. Bourges, l'un des deux jacobins qu'on
avait donnés à mon père pour être
les témoins de son supplice et de ses sentiments, vint
me trouver dans mon cachot, et me menaça du même
genre de mort si je n'abjurais pas. Peut-être
qu'autrefois, dans les persécutions
exagérées dont on nous parle, un proconsul
romain, revêtu d'un pouvoir arbitraire, se serait
expliqué ainsi. J'avoue que j'eus la faiblesse de
céder à la crainte d'un supplice
épouvantable.
- Enfin on
vint m'annoncer mon arrêt de bannissement; il
était resté quatre jours sur le bureau sans
être signé. Que d'irrégularités! que
d'incertitudes! La main des juges devait trembler de signer
quelque arrêt que ce fût, après avoir
signé la mort de mon père. Le greffier de la
geôle me lut seulement deux lignes du mien.
- Quant
à l'arrêt qui livra mon vertueux père au
plus affreux supplice, je ne le vis jamais; il ne fut jamais
connu: c'est un mystère impénétrable. Ces
jugements sont faits pour le public; ils étaient
autrefois envoyés au roi, et n'étaient point
exécutés sans son approbation: c'est ainsi qu'on
en use encore dans une grande partie de l'Europe. Mais pour le
jugement qui a condamné mon père, on a pris, si
j'ose m'exprimer ainsi, autant de soin de le dérober
à la connaissance des hommes que les criminels en
prennent ordinairement de cacher leurs crimes.
- Mon jugement
me surprit, comme il a surpris tout le monde: car si mon
malheureux frère avait pu être assassiné,
il ne pouvait l'avoir été que par moi et par
Lavaisse, et non par un vieillard faible. C'est à moi
que le plus horrible supplice aurait été
dû.
- On voit
assez qu'il n'y avait point de milieu entre le parricide et
l'innocence.
- Je fus
conduit incontinent à une porte de la ville; un
abbé m'y accompagna, et me fit rentrer le moment
d'après au couvent des jacobins: le P. Bourges
m'attendait à la porte; il me dit qu'on ne ferait aucune
attention à mon bannissement si je professais la foi
catholique romaine; il me fit demeurer quatre mois dans ce
monastère, où je fus gardé à
vue.
- Je suis
échappé enfin de cette prison, prêt
à me remettre dans celle que le roi jugera à
propos d'ordonner, et disposé à verser mon sang
pour l'honneur de mon père et de ma
mère.
- Le
préjugé aveugle nous a perdus; la raison
éclairée nous plaint aujourd'hui; le public, juge
de l'honneur et de la honte, réhabilite la
mémoire de mon père; le conseil confirmera
l'arrêt du public, s'il daigne seulement voir les
pièces. Ce n'est point ici un de ces procès qu'on
laisse dans la poudre d'un greffe, parcequ'il est inutile de
les publier; je sens qu'il importe au genre humain qu'on soit
instruit jusque dans les derniers détails de tout ce
qu'a pu produire le fanatisme, cette peste exécrable du
genre humain.
- A
Châtelaine, 23 juillet 1762.
- Signé:PIERRE
CALAS.
-
 Last modified: 21-Mar-00
Last modified: 21-Mar-00